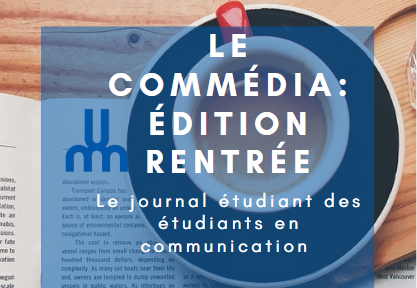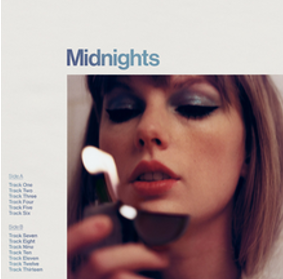Continuez à défiler pour les articles de notre édition rentrée!
Rubrique Quoi Faire: nos activités préférées du mois
Qu’on soit du coin ou d’ailleurs, Montréal est souvent perçue comme une ville étudiante vibrante et pleine de choses à faire. Pourtant, quand on a un petit peu de temps libre, il peut être complexe de trouver ce qu’on a envie de faire. Le ComMédia s’est donc dévoué à la tâche de rassembler les endroits à ne pas manquer dans notre belle ville.
Envie de grignoter?
État de choc
État de choc, c’est l’endroit par excellence pour les fervents amateurs de chocolat. En plus de sa boutique qui propose une variété de confiseries de qualité, État de choc offre des ateliers de fabrication de chocolat et de dégustation! C’est le cadeau parfait, que ce soit pour des proches ou pour soi-même (surtout utile en temps désespérés de mi-session)!
La Banquise
Difficile de trouver un met plus emblématique du québec que la poutine; toutefois, ce repas peut devenir redondant. Pour celles et ceux qui souhaiteraient un peu plus de variété dans leur poutine, La Banquise en vaut le détour! Les ingrédients qu’on y trouve dans ses plats (des merguez et du poulet pané, par exemple) peuvent sembler d’étranges additions, mais ils font plutôt de la dégustation de poutine une expérience surprenamment goûteuse.
Envie de relaxer?
Strøm Spa
Besoin d’évacuer le stress de la rentrée? Le Strøm Spa est l’endroit parfait pour le faire. Des massages au soins faciaux en passant par les expériences thermales et les aires de détente, une multitude d’options sont au bout de tes doigts pour te relaxer et profiter du plein air. Comment y résister?
Jardin de sculptures de Lachine
Pourquoi ne pas profiter de la nature tout en admirant le travail d’artistes de renommée? Le Jardin de Sculptures de Lachine abrite parmi ses beaux sentiers des œuvres d’art géantes, réalisées par des sculpteurs comme André Fournelle et Michel Goulet (https://www.mtl.org/fr). Ce parc consititue le plus grand musée en plein air au Canada, et peut être visité autant à pied qu’à vélo, selon votre envie de bouger (ou non)!
Envie de découvrir?
Festival quartiers danse
La chose la plus excitante du Festival Quartiers Danse? Il se trouve partout! En effet, selon MTL, le site de Tourisme Montréal (https://www.mtl.org/fr), les performances prenant place durant ce festival, qui a pour but de démocratiser la danse contemporaine, peuvent être vues dans plusieurs endroits publics tels que des musées, des centres communautaires, ou des marchés. On te conseille de garder l’œil ouvert pour les danseurs du festival! Sinon, plusieurs performances auront lieu à la Place des Arts en l’honneur de sa 20ème édition, mais il faudra s’y ruer, puisque l’événement prend fin le 18 septembre!
Circuits Urbains
Tu penses connaître ta ville? Les Circuits Urbains du Musée McCord Stewart te feront la découvrir sous un tout nouvel angle. À l’aide d’une application sur ton cellulaire, tu peux partir à l’aventure et découvrir 150 endroits cultes de Montréal et l’apparence de ceux-ci à l’époque, de par des photographies tirées à même la collection du musée. Parmi les nombreux choix de visites figurent des circuits abordant la mode du 19ème siècle ainsi que l’âge d’or de la magie. Une façon d’en apprendre plus sur Montréal qui est loin d’être ennuyeuse!
Sarah-Maude De Rive
Sources
(n.d.). MTL. (https://www.mtl.org/fr)
Rentrée musicale : 6 sorties d’album à ne pas rater cette session-ci !
Besoin de rafraîchir ta playlist pour la nouvelle session ? Ça tombe bien puisque les mois de septembre et d’octobre seront chargés en sorties musicales ! Au menu : des grands retours sur la scène musicale, des vedettes montantes et des albums surprises. Alors, sors ton calendrier (ou ton Google Calendar, si tu préfères) et prépare-toi à noter les dates de sortie de ces 10 albums à ne pas manquer cet automne.
1. Djo—Decide (16 septembre)
Lorsqu’il n’est pas dans le upside down, Joe Keery qui incarne Steve Harrington dans Stranger Things est dans le monde de la musique. Son premier album qu’il signe au nom de Djo, Decide, est une sortie à anticiper en ce mois de septembre. En attendant, tu peux passer en boucle ses derniers simples « Change » et « Gloom ».
2. Roselle—Aurore (21 septembre)
Chanteuse du groupe The Lost Fingers, Roselle est aussi choriste pour Les Louanges. Si ces noms te plaisent, la sortie de son prochain album, Aurore, risque d’être prometteuse pour toi ! L’attente ne devrait pas être trop pénible puisque tu peux déjà profiter de 4 opus, dont le très dansant « Je me posais cette question ».
3. Jason Bajada—Crushed Grapes (23 septembre)
L’auteur-compositeur montréalais Jason Bajada revient avec un septième album ce mois-ci intitulé Crushed Grapes. Si tu cherches quelque chose à mettre en boucle lors de tes sessions d’étude, son simple planant et rêveur « Walt Disney » est un bon indice que ce sera l’album pour toi. Ou tu peux aussi faire comme sur la couverture de la chanson et manger des nouilles ramen à bord de ta voiture. Chacun.e son style.
4. The 1975—Being Funny In A Foreign Language (14 octobre)
Le groupe britannique est de retour avec un nouvel album ce mois d’octobre et après trois ans de pandémie, The 1975 nous donne envie d’enfin sortir danser. Leur simple « Happiness », aussi disponible en version Dance Floor, possède leur son classique inspiré des années 80. À mettre dans ta playlist de soirée.
5. Daniel Bélanger — Mercure en mai (14 octobre)
L’auteur de « Les Deux Printemps », aussi devenu « TikTokeur » au cours de l’été, est de retour avec un dixième album, Mercure en mai. Pour être en mode automne ultime, tu peux aller écouter sa nouvelle chanson « J’entends tout ce qui joue ( dans ta tête ) » qui fera notamment partie de son prochain album.
6. Taylor Swift — Midnights (21 octobre)
Attention, attention, Swifties. Si vous n’étiez pas au courant (même si on en doute fort), madame Taylor Swift a annoncé au dernier gala des MTV Video Music Awards, la sortie de son dixième album Midnights. Définitivement à mettre en boucle lors des questionnements existentiels de mi-session et de fin de session…
Malaïka Kivuye
Sources
Genius – October 2022 Album Release Calendar. (n.d.). Genius. https://genius.com/Genius-october-2022-album-release-calendar-annotated
Genius – September 2022 Album Release Calendar. (n.d.). Genius. https://genius.com/Genius-september-2022-album-release-calendar-annotated
PalmarèsADISQ - Calendrier. (n.d.). PalmarèsADISQ. https://palmaresadisq.ca/fr/calendrier/date/2022-10-10/
Jason Bajada. (n.d.). Les disques Audiogramme inc. https://jasonbajada.net/fr/
Roselle. (n.d.). L-A be. https://l-abe.com/nos-artistes/roselle/
TikTok et santé mentale: devrait-on s'en méfier?
TikTok a connu une ascension en popularité en 2020, lorsque la pandémie a sonné à nos portes. L’application, étant à la base une plateforme de divertissement, s’est rapidement transformée en journal intime pour ses utilisateurs, où ceux-ci publient le fond de leur pensée et leurs activités quotidiennes. Le décalage souvent perçu entre la réalité de TikTok et la nôtre ainsi que le mode de fonctionnement de l’application choisi par ses créateurs laissent place aux doutes de plusieurs quant à l’effet négatif que cela peut avoir sur notre santé mentale.
Tendance malsaine
La première chose que j’ai remarquée, après avoir passé quelques minutes à faire défiler mon fil d’actualité TikTok, est que le concept des vidéos se ressemble souvent. Cela vient par vague de tendances : quelqu’un fait une vidéo de danse et obtient des millions de vues, donc la danse risque d’être reproduite d’innombrables fois. Ce qui peut sembler un peu répétitif, mais inoffensif, ne l’est pas toujours; tout dépend du contenu abordé. Andrea Lubeck, journaliste au Journal de Montréal, se penche vers la problématique de CleanTok, qui est une tendance sur TikTok où les utilisateurs montrent comment ils font le ménage chez eux. Elle mentionne dans son article : « Mais, à cause des algorithmes qui nous montrent les mêmes types de vidéos sans cesse, la motivation peut insidieusement laisser place à la comparaison sociale, voire à la culpabilisation, note la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier ». La plateforme médiatique peut donc créer une pression supplémentaire pour les utilisateurs, qui se demandent s’ils doivent en faire toujours plus. Ce mode de fonctionnement peut également être très néfaste chez les enfants, qui sont facilement influençables et vont être portés à reproduire le plus de tendances possible qu’ils vont voir sur cette application populaire.
Une représentation fictive de la réalité
Comme la plupart des réseaux sociaux de nos jours, l’application présente la vie des gens selon l’angle choisi par chaque créateur de contenu. Nous regardons pendant des heures les meilleurs côtés de leurs quotidiens, créant ainsi une sorte de réalité fictive inatteignable. Cela devient plus facile de se comparer aux autres, de voir que leur vie est plus mouvementée ou plus « intéressante » que la nôtre, ce qui peut définitivement jouer sur notre santé mentale. Un autre facteur qui amplifie cette impression de vie sans défauts est l’utilisation de filtres. Avoir une peau plus lisse, des dents plus blanches ou un nez plus mince font partie des choix proposés par ces filtres, qui encouragent l’obtention d’une apparence parfaite. Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef sur la plateforme médiatique CScience, mentionne : « […] la poursuite sans limite de son idéal esthétique pose un risque de développer une dépendance, un problème de santé mentale ou d’estime de soi ». Tout ce qu’on voit sur les réseaux sociaux étant susceptible d’avoir été modifié par le biais de filtres, il est donc important de toujours garder cette information en tête lorsque l’on se compare aux gens que nous trouvons plus-que-parfaits.
Janie Leclerc
Sources
Jammot, J. (2022, 2 mars). Des États américains enquêtent sur les effets « néfastes » de Tik Tok. La Presse. https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2022-03-02/sur-les-enfants/des-etats-americains-enquetent-sur-les-effets-nefastes-de-tiktok.php
Lubeck, A. (2021, 22 décembre). #CleanTok, une tendance TikTok qui peut affecter négativement votre santé mentale et physique. Le Journal de Montréal. https://www.journaldemontreal.com/2021/12/22/cleantok-une-tendance-tiktok-qui-peut-affecter-negativement-votre-sante-mentale-et-physique
Touma, C. (2022, août). L’impact des filtres Tik Tok sur la santé mentale. CScience. https://www.cscience.ca/2022/08/11/limpact-des-filtres-tiktok-sur-la-sante-mentale/
Trucs et astuces pour une rentrée organisée et plaisante
La rentrée à l’université est de nouveau là et avec elle viennent les appréhensions ; se perdre dans l’école, passer à côté de ses examens, ne pas réussir à suivre le rythme... Comment garantir une rentrée réussie ?
Conseil #1 : Préparez-vous en avance
Premier réflexe à adopter pour vous adapter : vous rendre sur le site web de l’université, de votre futur faculté et, bien sûr, consulter le programme. De plus, pour vous imprégner des lieux, vous pouvez profiter des activités organisées par l’UdeM pour découvrir votre future école. Vous allez ainsi pouvoir parcourir les lieux incontournables, les différents pavillons, les bibliothèques, les amphithéâtres, et plus encore. Vous gagnerez du temps le jour de la rentrée à chercher vos classes !
Conseil #2 : Ne pas attendre pour se mettre au travail !
Ça peut sembler redondant, mais c’est LE conseil à donner aux étudiant.e.s, surtout pour si vous venez d’arriver à l’université : Mettez-vous au travail tout de suite !
Lorsque l’autonomie est encore un terrain inconnu, on est largement tenté de remettre au lendemain toutes nos tâches du jour… Pour ne pas vous noyer dans les nombreux devoirs à rendre, vous pouvez vous munir de l’agenda de l’université afin d’organiser votre temps intelligemment. Pas question de manquer les premières journées ! Elles sont très importantes : les professeur.e.s vous expliqueront le déroulement du cours et ce sera l’occasion de prendre vos marques et vous familiariser avec les autres étudiant.e.s et avec la charge de travail!
Conseil #3 : S'installer dans sa vie étudiante
Peur de vous perdre seul dans un amphithéâtre avec de nombreux étudiants ? Inutile de paniquer, il est normal de se sentir un peu seul les premiers jours !
Les groupes de travail formés dans certains cours peuvent déjà servir de point de départ. Proposez à vos camarades d'aller étudier ensemble à la bibliothèque ! D’autant plus qu’ "étudier avec les autres peut permettre de débattre sur ce que l’on a compris et revenir sur ce que l'on n'a pas compris", comme nous y incite Nicolas Reverdy (L’Étudiant, 2019). Autre astuce : adhérer à une association. Des soirées organisées, animations sur la vie du campus, des débats autour de votre majeure, il en existe de nombreuses par faculté !
La rentrée à l’université signifie aussi prise d'autonomie. Pour vous assurer une rentrée réussie, votre vie parascolaire est essentielle. Si vous venez d’arriver à Montréal pour vos études, “pensez à repérer les transports qui vous amèneront à la fac, mais pensez aussi à vous adapter à votre nouveau lieu de vie avant la rentrée", conseille Sabine Lefebvre (L’étudiant, 2019). Carte Opus, allocations logement, il sera bien plus facile de vous consacrer à vos études si tous les petits tracas du quotidien sont réglés !
Solenn Douieb
Sources
Comment réussir sa rentrée à l'université ? (19 juillet 2022). L’Etudiant. https://www.youzful-by-ca.fr/c/les-etudes-superieures/comment-reussir-sa-rentree-luniversite
Taquet M., Petitdemange A., (29 juillet 2019). Bientôt la fac ? 3 astuces pour réussir sa rentrée à l'université. L’Etudiant. https://www.letudiant.fr/etudes/fac/comment-preparer-sa-rentree-a-l-universite.html
L'implication à l'université: pourquoi ne pas s'y mettre?
Dès que tu passes les portes de l’université à la rentrée, tu en entends déjà parler de tous les côtés : les initiations, les activités de ton programme, et surtout, ton association étudiante. Partie intégrante de la vie étudiante, elle est là tout au long de ton parcours avec de nouveaux évènements et projets. Toutefois, pour mettre tout cela en œuvre, l’association a besoin d’une équipe de feu!
Avec les élections de l’AÉCUM qui arrivent à grands pas, tu pourrais te demander l’intérêt de t'impliquer dans ton département. Pourtant, choisir de le faire, c’est de prendre part à quelque chose d’important et d’enrichissant! Pas convaincu.e? Voici quelques raisons pour lesquelles tu devrais t’impliquer auprès de l’université.
D’utiles connexions
On se le fait souvent répéter par nos enseignant.e.s : pour avoir un bon parcours en communication, il faut se créer des connexions, ce qui peut parfois sembler un peu intimidant. Or, prendre part à l’association étudiante te permet de faire toutes sortes de belles rencontres! Ceux qui sont d’abord des collègues deviennent vite des ami.e.s! Le sentiment d’appartenance qui vient avec le fait de t’impliquer dans ton programme peut te permettre de vivre tes années en communication à leur plein potentiel, de rester motivé.e dans tes études et de trouver du soutien quand tu en as besoin!
Du changement
L’université, ce n’est pas juste se présenter à ses cours, c’est faire partie d’une grande institution. Pour que ton expérience universitaire soit plaisante, pourquoi ne pas implémenter les idées qui, selon toi, pourraient améliorer cette institution? Devenir membre de l’AÉCUM te permettra de jouer un rôle plus actif dans la vie étudiante et d’échanger sur la gestion du programme, pour le bien de ton expérience et de celle des autres étudiant.e.s!
De l’expérience précieuse
Pour clore le sujet, cela semble évident, mais t’impliquer dans ton association paraitra très bien sur ton CV. Il s’agit d’un défi à relever, mais qui t’apportera beaucoup d’autonomie et d’expérience, expérience qui te démarque sur le marché du travail et auprès de l’université. Les connexions et les connaissances pratiques que l’AÉCUM te permet d’acquérir ne peuvent qu’être bénéfiques.
Si tu es intéressé.e, n’hésite pas à nous écrire au @aecum, et garde l’œil ouvert pour les postes à combler lors des élections de l’AÉCUM le 20 septembre!
Sarah-Maude De Rive
Sources
5 avantages de faire du bénévolat pendant ses études . (2021, 7 octobre). Université De Montréal . https://vieetudiante.umontreal.ca/experience-etudiante/blogue/5-avantages-de-faire-du-benevolat-pendant-ses-etudes
L’implication étudiante, un incontournable à l’université (2021, 4 août). Émerge. https://www.emergeconseil.com/post/l-implication-%C3%A9tudiante-un-incontournable-%C3%A0-l-universit%C3%A9
L'utilisation de Tik Tok et la guerre en Ukraine
Connue comme étant l’application de danse par excellence, Tiktok est en train de faire fureur en temps de conflit militaire. Les utilisateurs de ce réseau social nous montrent la réalité de la guerre en Ukraine. Depuis l’attaque des Russes, les usagers ukrainiens, partagent en abondance de courtes vidéos sur cette plate-forme médiatique. Certains soldats publient des danses permettant à leurs abonnés de savoir qu’ils sont bel et bien toujours en vie. Des habitants réalisent des vidéos qui ont pour objectif de montrer les bombardements, les dégâts commis, le chaos social bref, leurs nouvelles routines de vie. Toutes ces vidéos permettent au reste du monde de voir le déroulement de la guerre en direct et selon différentes perspectives et points de vue à savoir celui du militaire, mais aussi celui du peuple. Il s’agit d’informer, mais aussi de faire prendre conscience au reste du monde de la situation critique de leur pays.
De photographe à Tiktokeuse
La jeune fille, du nom d’utilisateur @valerisssh, divulgue au moins une vidéo par jour afin de partager un aperçu de sa vie en temps de guerre. À l’aide de musique, la jeune étudiante ukrainienne de 20 ans utilise un ton humoristique pour relayer les informations sur ce sujet. Comptabilisant plus des millions de vues par vidéos, une seule absence de sa part provoque une inquiétude et des interrogations de la part de ses abonnés: « I was worried coz you didn’t post on IG,hope you’re doing great » (Valerisssh sur TikTok, 2022). (« J’étais inquiet car tu n’as pas publié sur Instagram, j’espère que tu vas bien » [Traduction libre]). Reconnue internationalement grâce au réseau social Tiktok, elle reçoit beaucoup de support de ses abonnés via ses commentaires : « Sending love from Newfoundland, Canada »; « So much love from Italy »; « Sending love from New Jersey » (Valerisssh sur TikTok, 2022). (« J’envoie de l’amour du Newfoundland, Canada »; « Beaucoup d’amour d’Italie »; « J’envoie de l’amour du New Jersey » [Traduction libre]).
D’autres habitants ukrainiens documentent la guerre en faisant des « live » sur Tiktok afin de montrer au monde entier ce qu’ils subissent. Ils utilisent davantage cette application comme outil didactique pour le reste du monde. Ils désirent mettre en lumière les bombardements et tous les dégâts qui en découlent, et ce, en espérant obtenir de l’aide; c’est un cri de détresse.
Révéler sa survie au travers de son téléphone
C’est avec fierté nationale que les soldats ukrainiens se filment en réalisant de courtes danses. Plusieurs montrent leurs armes avec sourire, en gardant en tête que c’est peut-être leur dernier souvenir enregistré…
Certains utilisent Tiktok comme moyen de communication afin de véhiculer à leurs abonnés un message précis, dans ce cas, leur existence. Publier des vidéos Tiktok chaque jour permet aux abonnés de savoir si les soldats sont toujours en vie. Les usagers les supportent énormément et sont nombreux à écrire des mots d’encouragement dans les commentaires, en leur demandant de rester sain et sauf.
La technologie en temps de guerre
Les habitants ukrainiens ainsi que les soldats ont su utiliser de manière utilitaire l’application Tiktok. Ils ont su utiliser cette plateforme pour documenter l’évènement d’actualité.
La technologie a su s’intégrer même dans des états de conflits. Ce qui n’était pas le cas lors de la première et deuxième guerre mondiale.
Comme le dit Laurence Grondin-Robillard, coordonnatrice des communications du GRISQ, « C’est la Première Guerre qu’on voit en direct et sur TikTok. On n’a jamais eu de moment historique documenté avec une telle rapidité. » (Ferah, 2022).
Ce réseau social va contribuer à informer les jeunes des horreurs de cette guerre. Il faut tout de même rester prudent vis-à-vis de certaines vidéos, protéger son esprit critique, et ne pas dédramatiser ce conflit armé.
Dahlia Larbi
. . .
SOURCES
Ferah, M. (2022, March 12). Guerre en Ukraine | TikTok comme arme de guerre. La Presse. https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-03-12/guerre-en-ukraine/tiktok-comme-arme-de-guerre.php
Redirect Notice. (2022). Google.com. https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F98037%2Fsoldats-debaltseve-texto&psig=AOvVaw0h_kcpcQCh9YlGY89oMLrG&ust=1647218842361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMDR2sLuwfYCFQAAAAAdAAAAABAQ
Redirect Notice. (2022). Google.com. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fca.finance.yahoo.com%2Fnews%2Fukrainian-tiktoker-shows-stark-reality-115010234.html&psig=AOvVaw3Yqzn6HdrJlu7dt0WYMBIt&ust=1647218982070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJjXy4TvwfYCFQAAAAAdAAAAABAJ
Valerisssh sur TikTok. (2022, March 7). TikTok. https://www.tiktok.com/@valerisssh/video/7072462413156617477?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=fr
Valerisssh sur TikTok. (2022, March 11). TikTok. https://www.tiktok.com/@valerisssh/video/7073777078134525189?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=fr
Entrevue exclusive avec l'éditorialiste en chef de LaPresse
Vous vous posez des questions sur le métier de journaliste? Vous souhaitez en apprendre davantage sur cette carrière? Le ComMédia vous offre une occasion unique de répondre à vos interrogations!
Notre rédactrice Carol Ann Asselin a mené une entrevue exclusive avec l'éditorialiste en chef de LaPresse, Stéphanie Grammond pour vous aider.
Le lien de l’entrevue est sur notre page FaceBook : https://www.facebook.com/AECUMCOMMEDIA
PS : N’hésitez pas à jeter un œil au site de la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec , vous pourriez y trouver des stages et des informations importantes!
Bonne écoute! 🖋
Le genre à l'Université : quelle place pour les personnes queers ?
En début d'année, j'ai vécu près de 6 mois de questionnements sur mon identité. La pandémie m'avait fait passer trop de temps avec moi-même, à tel point que je ne savais plus qui j'étais. Je suis passée par beaucoup d'émotions, allant de l'incompréhension au soulagement, en passant par une colère immense : pourquoi fallait-il que ça "tombe" sur moi ? Après maintes et maintes recherches sur le sujet, j'ai découvert un domaine complètement inconnu pour moi : le queer. Je trouvais enfin des mots à mettre sur ce que je ressentais. Et là je me suis demandé : "mais pourquoi on n'en parle pas à l'Université ?". Malgré plusieurs cours en cinéma, communication, philosophie, etc., le sujet n'est pas tant abordé, du moins pas par tou.te.s les étudiant.e.s. Pour en savoir un peu plus, j'ai posé quelques questions à Charline, une étudiante genderfluid, et à Joëlle, une personne queer et une professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'UdeM, qui s'intéresse notamment aux questions queer et de genre.
UN MANQUE DE RESSOURCES ÉVIDENT
D'après Joëlle, il serait important "d'avoir une équipe "spécialisée" au sein du service psychologique [de l'UdeM]". En effet, dans leur article, Marion Bernard et ses collègues expliquent que l'OMS a récemment déclaré "l'état d'urgence mondial concernant la prévention du suicide et identifie les personnes LGBT[+] comme un groupe particulièrement vulnérable". Un phénomène expliqué entre autres par les discriminations auxquelles fait face cette communauté. Il pourrait donc s'avérer judicieux de rendre l'Université safe pour les personnes queers, surtout lorsqu'on considère que leur foyer familial est bien souvent peu sécurisant.
Charline suggère d'augmenter la visibilité des ressources LGBT+ disponibles à l'UdeM. Pendant la pandémie, ses questionnements de genre se sont amplifiés, et malgré ses recherches, elle n'a trouvé aucun groupe de soutien actif, ni de témoignages d'étudiant.e.s vivant la même situation qu'elle à l'Université. Comment pouvons-nous imaginer vivre serein si l'on a l'impression que ce que nous vivons est un cas isolé ? D'après elle, les questionnements sont rendus plus difficiles lorsqu'on n'a "jamais entendu parler qu'il pouvait y avoir plus que les genres binaires [homme/femme]".
UN RÔLE À DÉFINIR ET À INCARNER
Mais alors, quel rôle l'Université devrait-elle jouer dans l'accompagnement des personnes queers ? Comment faire pour qu'elles se sentent soutenues et puissent s'exprimer pleinement ? Charline s'enthousiasme de la liberté qui est accordée à l'UdeM : "de souvenir, je n'ai jamais eu de souci particulier avec aucun.e.s profs". En revanche, elle regrette le manque de soutien, ce qui lui paraît surprenant "dans une université aussi importante". Avec son point de vue plus interne, Joëlle nuance en précisant que l'UdeM a été plutôt lente dans ses processus par rapport aux autres universités montréalaises, en reconnaissant tout de même qu'aujourd'hui, les étudiant.e.s ont la possibilité de modifier leur nom inscrit à leur dossier. Considérant l'Université comme "un lieu de recherche et de partage des connaissances", elle suggère d'encourager encore plus les projets de recherche sur ces questions et surtout, de permettre le partage de ces connaissances. Elle recommande également d'offrir des formations aux "personnes non LGBT+ qui en auraient besoin afin de décharger les personnes LGBT+ face à ce rapport pédagogique". En bref, elle pense qu'éduquer les personnes non queers retirerait la charge mentale des personnes queers, qui doivent (presque) toujours éduquer les autres. Elle suggère enfin que les étudiant.e.s et employé.e.s qui en ressentent le besoin se rencontrent. Chaque personne gère cela différemment et certain.e.s préféreront intégrer des communautés extérieures au cadre académique ou professionnel.
Pour Charline, il serait également souhaitable d'organiser des événements ou des séances de sensibilisation à la cause queer. "Je pense qu'il faudrait des ressources visibles. [...] Je pense que beaucoup de choses pourraient être faites, rien que pour mettre en contact les étudiant.e.s LGBT+ [...]", affirme-t-elle. Elle suggère aussi un programme de pair.e.s aidant.e.s queers, comme déjà mis en place dans le département de Communication mais sans la dimension LGBT+. Pourquoi ? Parce que sortir des normes fait peur et qu'il peut être dangereux pour une personne queer d'exprimer son identité. Or, lorsqu'on s'adresse à une personne déjà concernée et éduquée sur le sujet, la confiance est nettement plus grande.
"En tant que professeure ouvertement queer, je constate jouer un rôle de visibilité, de présence", m'explique Joëlle. Elle poursuit : "j'ai également un rôle pédagogique et d'accompagnement dans une réflexion intellectuelle". Lorsqu'elle est sollicitée, elle redirige les étudiant.e.s vers des services communautaires. Elle rappelle qu'il pourrait aussi y avoir ce genre de service au sein de l'UdeM, mais que ce n'est pas encore tout à fait là. Les professeur.e.s auraient-ils tou.te.s un rôle à jouer dans cet accompagnement ? Pas sûr que cela soit en tout cas souhaitable. "On constate une augmentation de la prise de conscience mais cette augmentation de "visibilité" entraîne également une résistance [comme dans la société de manière générale]", ajoute-t-elle. Difficile donc de réussir à créer un corps professoral 100% queer- friendly. Et si les professeur.e.s manifestent une opposition à aider les étudiant.e.s LGBT+, cela pourrait avoir des répercussions graves sur leur santé mentale. Mais alors, on ne fait rien ?
POURQUOI L'UNIVERSITÉ A-T-ELLE UN RÔLE À JOUER ?
Comme l'expliquent Farinaz Fassa et ses collègues, "l'école n'est pas neutre". Et selon Véronique Rouyer et ses collègues, elle reproduirait même "les inégalités présentes dans la société", incluant celles par rapport au genre. Un avis partagé par Joëlle, qui me dit que "les universités sont aux prises avec les mêmes problématiques d'exclusions, d'homophobie et de transphobie que les milieux sociaux". L'article a également démontré que les manuels scolaires jouent un rôle dans la perpétuation des modèles cishétéronormatifs. Étant donné qu'une bonne partie de notre éducation se fait en dehors de la maison, il serait bon de la soigner en révisant les ressources actuelles et en les adaptant à la réalité d'aujourd'hui : la norme binaire (homme/femme) ne convient plus.
Ophélie Barbotte.
Sources:
Bernard, M., Wathelet, M., Pilo, J., Leroy, C. & Medjkane, F. (2019). Identité de genre et psychiatrie. Adolescence, 371, 111-123. https://doi.org/10.3917/ado.103.0111
Fassa, F., Fueger, H., Lamamra, N., Chaponnière, M. & Ollagnier, E. (2010). Éducation et formation : enjeux de genre. Nouvelles Questions Féministes, 29, 4- 16. https://doi.org/10.3917/nqf.292.0004
Markus Spiske · Photographie. (s. d.). Consulté 4 décembre 2021, à l’adresse https://www.pexels.com/fr-fr/@markusspiske
Touyer, V., Mieyaa, Y., & Blanc, A. le. (2014). Socialisation de genre et construction des identités sexuées. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, 187, 97‑137. https://doi.org/10.4000/rfp.4494
Santé mentale : un combat parfois silencieux
Il y a deux ans, j’ai été diagnostiquée d’un trouble de la personnalité limite, plus communément connu sous le nom de « borderline personality disorder », ainsi que d’un trouble anxieux. Il va sans dire que ces dernières années ont été un réel défi pour moi. Les troubles anxieux étant eux-mêmes assez courants, les troubles de la personnalité sont très différents et résultent la plupart du temps d'un traumatisme, d’une prédisposition génétique ou encore d’un déséquilibre chimique dans le cerveau. Il m'a cependant fallu attendre un certain temps avant d’obtenir le bon diagnostic, les symptômes du TPL étant fortement similaires à ceux du trouble bipolaire. La partie la plus difficile quand on souffre d'un trouble psychique, c’est la manière dont la société a tendance à nous dépeindre. En effet, les personnes atteintes de maladies mentales sont très souvent vues comme manipulatrices, dangereuses, impuissantes et égoïstes, toutes des idées reçues. Les gens ne sont toujours pas assez éduqués en matière de santé mentale et c’est quelque chose qui, de nos jours, vient réellement poser problème.
Il y a 5 ans, j’ai eu à faire le deuil d’un ami après des années de lutte contre la dépression. Lorsqu’il s’agit de suicide, au lieu d’apporter l’aide nécessaire à la personne en détresse, il est toujours plus facile de passer outre et d’ignorer les signes. On nous dit que certains l’ont eu pire, que ce n’est qu’une mauvaise passe, qu’il est inutile de dramatiser... C'est malheureusement ce qui arrive lorsque quelqu’un se résigne enfin à demander de l’aide : personne ne semble prendre la situation au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nul ne peut savoir ce que traverse autrui et ce qu’il se passe véritablement dans sa vie. Vivre avec la dépression ou toute autre condition psychologique ne signifie pas nécessairement passer la journée entière à pleurer dans son lit ; c’est aussi souffrir en silence tout en gardant le sourire. Ce n'est pas parce qu’une personne a vécu l’expérience d'une certaine manière qu’elle se manifestera automatiquement de la même façon pour une autre. Ce qui me désole le plus dans tout ça, c’est qu’avoir des problèmes de santé mentale est devenu tendance chez les plus jeunes, voire même une sorte d’esthétique sur les réseaux sociaux. Désormais, le terme « dépression » est utilisé à tout va et dans n’importe quel contexte, ce qui tend à décrédibiliser ceux ou celles souffrant réellement de la maladie.
Ce que la société a du mal à comprendre c’est qu’aujourd’hui, l’utilisation de termes psychologiques tels que « bipolaire » pour décrire un état d’esprit ou un mauvais tempérament vient davantage contribuer à l’augmentation de la stigmatisation autour de la santé mentale. C'est pourquoi il est primordial de se renseigner davantage sur le sujet, afin de briser une fois pour toutes le tabou. C'est un enjeu réel qui doit cesser d’être à la fois démonisé et romantisé. Vivre avec un trouble psychique est un combat quotidien pouvant toucher n’importe qui et qui nécessite beaucoup plus de reconnaissance; ce n'est pas un choix et encore moins une honte. Il est normal de lutter et souffrir en silence ne devrait jamais être une option.
Margot Duga
Source
Image: La santé mentale au travail : Une question de gros bon sens. (s. d.). Consulté 4 décembre 2021, à l’adresse https://www.revuegestion.ca/la-sante-mentale-au-travail-une-question-de-gros-bon-sens
Un évènement imprévu
La vie est une boucle. On apprend à vivre d’une certaine manière et chaque choix, chaque pas que nous faisons nous rapporte toujours vers la même direction. Lorsqu’on enlève leurs repères aux hommes, ceux-ci sont complètement perdus et perdent une part de ce qu’ils sont, ne savent plus comment se comporter. La pandémie est une très bonne illustration de cette affirmation et c’est ce que nous démontre l’histoire de Marlène Gibaud.
Marlène est secrétaire. Elle a 59 ans et habite à Saint Cyr L’école. Elle est divorcée et n’a aucun enfant. Tous les matins, Marlène se lève à sept heures, boit son café noir avec un demi-sucre et monte dans sa voiture à huit heures pile. Elle allume la radio et se met à fredonner sa chanson préférée, « I started a joke « des Bee Gees. Son trajet dure quinze minutes et la conduit jusqu’au parking de la maison de repos Saint Julien.
La maison de repos, elle la connaît bien. Elle en connaît tous les employés, les habitudes et tous les petits recoins. Effectivement, cela fait près de six ans que Marlène vient rendre visite à sa mère tous les jours. Chaque jour, chaque week-end, de 8h15 à 9h, Marlène est présente pour sa mère Ginette, âgée de 95 ans. Les deux femmes ont une relation très fusionnelle : Ginette a élevé Marlène toute seule et l’a accompagnée tout au long de sa vie. Marlène ne peut donc pas s’empêcher de lui rendre la pareille depuis son installation en maison de repos.
Cependant, avec l’arrivée de la pandémie, les habitudes de Marlène ont toutes été modifiées. Cette femme qui dévouait tout son temps à sa mère et à son bien-être se retrouve désormais enfermée chez elle, et n’a maintenant aucune possibilité de lui rendre visite.
Lassée de ce qu’elle considère comme un emprisonnement, Marlène décide un jour de se rendre à la maison de repos, et ce sans aucune autorisation préalable. La chambre de sa mère se trouvant au rez-de-chaussée, Marlène fait discrètement le tour du bâtiment et tapote à la vitre de façon discrète et rapide. Les rideaux s’ouvrent, dévoilant le sourire de Ginette, très heureuse de retrouver sa fille adorée. Malheureusement, la pandémie et la fragilité de Ginette les empêchent de se rapprocher.
Marlène, masquée, ne supporte finalement pas cette situation, se sent très vite oppressée. Elle a beaucoup de chagrin à voir sa mère enfermée ainsi et de ne pas pouvoir la soutenir comme à l’ordinaire.
Au lieu d’apporter du réconfort à Marlène, cette visite clandestine et imprévue est finalement un désastre. Le fait de devoir échanger avec sa mère à travers une fenêtre sans pouvoir lui parler ou la tenir dans ses bras est une expérience traumatisante. Même si elle attend avec impatience que soit redonnée l’autorisation de visite dans les maisons de retraite, Marlène se demande si elle sera capable d’y aller aussi fréquemment qu’auparavant et de retrouver la joie qui l’accompagnait à chaque visite.
L’expérience pandémique l’a profondément angoissée, et a indirectement impacté sa relation avec sa mère.
Elle qui était pétrie d’habitude et rassurée par son petit train-train, elle est surprise qu’un événement comme celui-ci puisse engendrer une telle réaction chez elle. Elle ne se reconnaît plus.
Anja Conton
Représentation ethnique dans le cinéma d’époque : la controverse de La chronique des Bridgerton
Avez-vous déjà regardé La chronique des Bridgerton ? La série sortie le 25 décembre 2020 a été un très beau cadeau de Noël pour près de « 82 millions de foyers abonnés à la plateforme Netflix » (Radio-Canada, 2021). Se déroulant en 1813, la première saison de la série suit le personnage de Daphne Bridgerton, fille ainée du défunt vi-compte de Londres, lors de la saison mondaine. Saison durant laquelle les jeunes adultes de la haute société doivent trouver leur future femme ou futur mari. Daphne est désignée, au tout début de l’épisode un, comme le diamant de la saison par la reine d’Angleterre. Entre drames et amour, les spectateurs suivent l’histoire des différents personnages lors de cette saison mondaine. À première vue, cette série n’aborde pas de sujets problématiques ou controversés, mais c’’est pourtant une vague déferlante de critiques et de haine qui a ravagé les réseaux sociaux après sa sortie, la cause étant l’origine ethnique de certains acteurs.
En effet, nous pouvons retrouver dans la haute société de Londres du XIXe siècle un grand nombre de personnes racisées et issues de minorités. La critique se fonde donc sur le manque de réalisme de la série.
© La Chronique des Bridgerton / Netflix)
Il n’est pas difficile de comprendre que la distribution de La chronique des Bridgerton n’a malheureusement rien à voir avec la réalité de l’époque. Des tweets tels que « la diversité dans les drames d’époque ne fonctionne pas » ont fait beaucoup de bruit dans le monde des médias. L’emploi du terme « fonctionner » est quelque peu perturbant ici, car il est difficile de comprendre en quoi la présence d’acteurs issus de minorités entrave la trame de l’histoire. Est-il acceptable de comparer l’importance de la couleur de peaux des personnages présents dans cette série avec ceux présents dans un film comme Twelve years a slave (Steve McQueen), où la couleur de peau des acteurs et actrices est directement liée au rôle qui leur est accordé? Dans ce type de films, la couleur de peau joue un rôle majeur dans l’histoire puisque c’est bel et bien la pièce maîtresse de l’histoire. Cependant, dans le cas de la série La chronique des Bridgerton, la couleur de peau et l’histoire en général ne font pas partie de la trame narrative. Les cinéastes ont plutôt décidé d’utiliser les éléments de l’époque qui leur importait pour l’histoire, comme l’esthétique, l’importance de la hiérarchie, etc. Toutefois, c’est leur droit de ne pas prendre en compte d’autres aspects de la réalité de l’époque.
De plus, cela donne en fait des opportunités de travail aux acteurs issus de minorités. L’acteur Omar SY nous dit qu’il « n’y a pas assez de diversité sur la scène artistique » (Ouest-France, 2016). En effet, le manque de diversité chez les acteurs hollywoodiens est flagrant. Selon Radio-Canada « si elle a légèrement augmenté pour se situer à 19,8 % en 2017, la proportion d'acteurs non blancs est loin d'égaler leur part dans la population américaine, évaluée à environ 40 % » (2019). Donc renforcer cet écart avec comme seule excuse que « ça ne colle pas avec l’histoire », alors que l’importance de ce facteur est moindre, ne vaut pas vraiment le coup. Il serait peut-être temps de reconnaître l’importance de la représentation et de laisser de côté la réalité historique que d’autre films dramatiques de l’époque, comme La Duchesse (Saul DiBbb) portraient parfaitement. Ne faudrait-il pas commencer à accepter les deux façons de faire ?
Au même moment, de l’autre côté des réseaux sociaux, une autre équipe prend forme : elle est formée de ceux qui critiquait l’inexistence de la mise en avant des différences raciales dans la série. Cette équipe parle elle aussi de manque de réalisme, mais dans ce cas, elle se soucie davantage des problèmes de société actuels, qui sont totalement mis de côté, qu’au manque d’exactitude historique. Certains spectateurs déplorent l’inexistence de lutte raciale ou de représentation de situations injustes vécues par les minorités.
Néanmoins, il ne faut pas oublier le but des œuvres artistiques en générale. Pouvons-nous blâmer l’auteure du livre fantastique, car il n’est pas assez réaliste et conscient de ce qu’il se passe réellement dans le monde? Les artistes cherchent à créer et les cinéastes ne sont pas une exception et ne devraient pas l’être. Que ce soit des émotions, des histoires ou encore des mondes, le but final est d’être original et de s’exprimer avec pour seules limites celles qu’ils s’imposent. Ainsi, est-ce judicieux de blâmer l’artiste qui imagine un monde dépourvu de haine raciale et qui, par conséquent, ne cherchera pas à la dénoncer? C’est d’ailleurs peut-être en « normalisant » ces représentations que le cinéma pourrait faire réellement une différence.
Enfin la question de l’origine ethnique des acteurs est souvent et peut-être trop souvent remis sur la table dans les médias, que ce soit les médias de masse ou les réseaux sociaux. Shonda Rhimes, l’une des productrices de la série et aussi productrice de séries télévisées à succès comme Grey’s Anatomy ou Scandal, a souvent été sujette à de nombreuses critiques pour la mise en avant de couples interraciaux. Aussi, bien que ce soit une vision très futuriste et peu réaliste pour l’époque à laquelle nous vivons, celle-ci décide souvent de ne pas mettre en avant les épreuves auxquelles peuvent faire face les couples interraciaux dans le monde extérieur. Le message qu’elle essaie de faire passer en continuant ce trope malgré les critiques est peut-être d’arrêter de voir les êtres humains comme des noirs, des blancs, des latinos… mais plutôt comme des personnes. Cette vision est-elle un peu trop utopique? Faudrait-il justement prendre en compte ces facteurs pour faire une différence, car fermer les yeux ne mène à rien? Ou alors est-ce justement en fermant les yeux sur ces facteurs et en rendant cela « normal » au cinéma qu’il peut effectivement y avoir un impact sur la vision du monde des spectateurs ?
© La Chronique des Bridgerton / Netflix
Article écrit par Samantha Antoine
Références :
Radio-Canada. (2021, 29 janvier). La chronique des Bridgerton bat un record de visionnements, selon Netflix. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766973/chronique-bridgerton-record-visionnements-netflix
Agence France-Presse. (2019, 22 février). Les femmes et les minorités toujours nettement sous-représentées à Hollywood. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154544/hollywood-femmes-minorites-visibles-discrimination-cinema
Help : Que faire après mes études ?
Il t’est sûrement déjà arrivé de te demander ce que tu voulais faire après ton diplôme en communication. Continuer tes études ? Te lancer dans le monde professionnel ? Prendre une année sabbatique ? Les possibilités sont nombreuses, et c’est d’ailleurs pour ça que tout est si flou. Pas de panique, tu n’es pas seul.e à avoir ces questionnements et je te propose aujourd’hui quelques conseils pour aborder cette question avec plus de sérénité.
Pourquoi es-tu obsédé.e par cette question ?
On nous répète depuis toujours que l’on doit avoir un objectif de vie, une carrière qui doit être tracée à l’avance comme condition de réussite. À force, on est persuadé que si on ne sait pas où on va, on ne réussira jamais. Si tu as besoin de cinq ans pour trouver ta voie, alors prend-les. Personne n’a à te juger sur le chemin que tu décides de prendre. De plus, ton orientation professionnelle n’est pas figée. Il faut plutôt voir ça comme quelque chose de fluide, qui change avec le temps, notre propre évolution et le contexte dans lequel on vit (regarde le nombre de personnes qui se sont trouvées des vocations pendant le confinement !). En plus, la communication est un secteur d’activité en pleine croissance. Ça veut dire que le métier que tu feras plus tard n’existe peut-être pas encore à l’heure actuelle. Et puis, tu peux même créer ton propre métier si tu n’en trouves pas qui te corresponde vraiment.
Conseils pour t’aider dans cette quête
Si ce questionnement te prend vraiment trop la tête, tu peux faire plusieurs choses pour t’aider à diminuer ce tourment.
J’ai parlé tantôt de l’année sabbatique. Parfois, il peut s’avérer utile de prendre du temps pour soi, pour se poser et réfléchir à ce qu’on veut faire de notre vie. Ça peut être un mois, six mois, trois ans, peu importe. Si voyager dans un pays étranger et découvrir une nouvelle culture et de nouvelles personnes t’aident à trouver qui tu es et ce que tu veux faire de la vie, alors fais-le. Aujourd’hui, les recruteurs sont généralement plus compréhensifs face à ce genre de choses, donc ça ne fera pas « tache » sur ton C. V.
Des recherches sur ce qui t’intéresse
Internet est ton ami. On a la chance de pouvoir chercher des informations et trouver (90% du temps) une réponse satisfaisante. Plus besoin de se plonger dans des livres. Désormais, témoignages, fiches métiers, vidéos, podcasts, etc. sont à ta disposition en ligne. Il existe mille et une façons de trouver de l’information sur ce que tu cherches. Tu ne sais pas par où commencer ? Je te conseille de dresser un tableau avec trois colonnes : ce que tu aimes un peu, ce que tu aimes beaucoup et ce que tu n’aimes pas. Parmi ce que tu as déjà fait en communication (ou même ailleurs), place les éléments dans les colonnes.
Dans la première colonne, écris les choses qui t’intéressent, mais sur lesquelles tu ne passerais pas tout ton temps non plus. Dans la deuxième colonne, ce sont les choses que tu préfères faire ou qui t’intéressent vraiment. Ce sont des activités qui t’inspirent et te motivent. C’est là-dessus que tu dois prioriser tes recherches et essayer de contacter des professionnels car tu te vois éventuellement en faire ton métier. Dans la troisième colonne, ce sont les activités que tu ne veux absolument pas réaliser dans ton travail. Par exemple, si la gestion de réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas pour toi et que tu tombes sur une offre d'emploi dans laquelle 50% de ton travail sera de gérer les communautés de ton entreprise, alors je pense que pour ta survie, il est préférable d'en chercher une autre. Après, c'est à toi de voir si tu veux faire des compromis. Une fois le tableau fait (il peut évidemment évoluer au fil du temps), tu sais sur quoi prioriser tes recherches.
Si tu ne sais pas où chercher, tu peux regarder sur les sites spécialisés comme Le Grenier aux Nouvelles car il y a certains articles qui font des focus sur certains métiers de la communication. Les sites des agences de communication font aussi souvent des points sur leurs métiers en présentant les services qu’elles offrent à leurs clients. Si tu veux avoir un aperçu rapide d’une discipline, comme les relations publiques par exemple, jeter un œil à sa page Wikipédia peut toujours te donner des pistes. Regarder les offres d’emploi te permettra aussi de voir les tâches qui sont souvent associées à certains métiers, donc de voir un peu plus concrètement ce que tu devras y faire (il y en a sur LinkedIn, Isarta, Espresso Jobs, Indeed, Welcome to the Jungle, pour ne pas être exhaustive). Tu peux aussi chercher des personnes qui exercent un métier qui t’intéresse et regarder leur parcours universitaire et professionnel (s'il est disponible sur LinkedIn). Sinon, il existe des chaînes YouTube qui traitent des métiers de la communication comme Ikigai, qui s’adresse d’abord aux entrepreneurs, mais tu y trouveras tout de même plusieurs vidéos sur la communication, expliquée par des professionnels. Pour ce qui est des podcasts, Clavardage et Influence Digitale peuvent être des bons points de départ.
N’oublie pas que la plupart de nos chargé.e.s de cours travaillent ou ont déjà travaillé pour des clients réels et qu’ils savent donc comment ça se passe sur le terrain. N’hésite pas à leur envoyer un courriel : ils sont plus faciles à atteindre que des professionnels avec qui tu n’as aucune attache.
Affiniti de l’UdeM
J’ai l’impression que cet outil est passé pas mal inaperçu auprès des étudiant.e.s, et pourtant, je l’ai trouvé très pertinent. Tu dois seulement cocher trois centres d’intérêt parmi une liste prédéfinie, puis l’outil te donne tous les programmes à l’UdeM (que tu ne connais peut-être pas) qui te correspondent : baccalauréat, majeure, mineure, microprogramme, certificat, etc. Ça peut être l’occasion pour toi de te former à quelque chose de nouveau, ce qui te laissera un peu plus de temps pour réfléchir et te préparer au monde professionnel.
Les groupes Facebook d’(anciens) étudiant.e.s
Tu dois sûrement déjà être dans le groupe Comm+1 avec tes camarades des programmes de communication de l’UdeM. Tu peux y poser toutes tes questions et partager tes doutes car, je te l’assure, un bon nombre de personnes ont les mêmes que toi ! Si tu souhaites plutôt parler avec des personnes (sûrement) plus avancées dans leur orientation professionnelle, tu peux te diriger vers le groupe des étudiant.e.s aux Cycles supérieurs en communication (UdeM). Ils connaissent mieux que toi le milieu et pourront te conseiller et te donner des pistes à creuser pour trouver ta voie.
Le mentorat
Enfin, si tu as vraiment besoin de concret, tu peux toujours opter pour le mentorat. Academos et Mentorat Québec sont des plateformes spécialisées dans ce domaine et elles peuvent te mettre en contact avec des professionnels qui travaillent dans le secteur qui t’intéresse. C’est une formule un peu spéciale qui demande un certain niveau d’engagement des deux côtés. Donc, si tu préfères faire tes recherches tranquillement dans ton coin, je ne te conseille pas cette option. En revanche, si tu es décidé.e à trouver ta voie, alors fonce !
Laisse-toi du temps
Finalement, le meilleur conseil que je peux te donner, c’est de te laisser du temps. Si tu ne te sens pas prêt.e à faire ça dès aujourd’hui, ce n’est pas grave. Fais-le à ton rythme et respecte-toi. Tu verras que quand tu iras mieux, la réponse se révélera d’elle-même. :)
Écrit par Ophélie Barbotte
Crédit photo : © Christin Hume / Unsplash
Le malade imaginaire
Le 30 janvier dernier, le ComMédia a eu la chance d’aller voir la première médiatique de la pièce Le malade imaginaire, présentée au Théâtre du Rideau-Vert du 28 janvier au 29 février. Cette pièce est inspirée des textes de l’ultime pièce écrite par Molière et mise en scène par Michel Monty.
Tout d’abord, il faut dire qu’à lui-seul, le jeu des acteurs vaut le détour! En effet, la distribution comporte beaucoup de talent. Il faut évidemment parler de Luc Guérin, jouant Argan, le fameux « malade », qui arrive à transmettre au public sa peur de la maladie et qui invoque la pitié du public en se montrant si fragile et, malheureusement, dupe. Ensuite, Patrice Coquereau et Frédérick Tremblay forment un magnifique duo père et fils médécins, répondant parfaitement au stéréotype du père ayant le parfait contrôle sur son fils et étant très autoritaire tandis que le fils est si effrayé par celui-ci qu’il a même du mal à s’exprimer. Il va sans dire que nous ne pouvons parler de la distribution sans parler de Benoit Mauffette qui se met dans la peau d’un notaire exécrable, mais aussi du frère du malade imaginaire. Ces deux personnages sont à l’opposé l’un de l’autre ; alors que le notaire est laid et hypocrite, le frère du malade est plutôt bienveillant. Or, le comédien arrive à nous faire croire que ces deux personnages existent et que ce sont des personnes différentes grâce à son jeu. Une autre comédienne mérite une mention spéciale, bien que toute la distribution soit excellente, puisque chacune de ses apparitions sur scène a pour effet que le public se tord de rire. Je parle ici d’Émilie Lajoie, qui joue Béline, l’épouse du malade imaginaire, et ainsi la belle-mère de la fille de ce dernier, Angélique, interprétée par Anne-Marie Binette. Ce personnage n’en veut définitivement qu’à l’argent de son époux et il faut mentionner que l’accent québécois datant du 20e siècle que la comédienne utilise est à se tordre de rire! Didier Lucien, Anne-Marie Binette, Violette Chauveau et Maxime Mompérousse font également partie de la distribution et sont tous très crédibles et ancrés dans leurs rôles respectifs. D’ailleurs, le spectateur assistant à la représentation ne peut que prendre conscience de la belle complicité qui unit toute la distribution et qui fait en sorte que les acteurs s’inspirent entre eux et rendent la pièce encore plus palpitante.
Par la suite, le travail de Michel Monty est également à souligner! Un spectateur n’ayant jamais lu Molière auparavant ne sera pas du tout en reste. La pièce a été adaptée au goût de jour et s’applique parfaitement à notre société d’aujourd’hui. Les dialogues ont donc été réécrits selon notre langage plus moderne et certains éléments de la pièce ont été bonifiés. La pièce était très légère, avec quelques références plus matures pour les spectateurs plus âgés, mais elle convient parfaitement à tous les âges! Le ton était très humoristique et je peux dire que je n’ai jamais passé plus de cinq minutes sans rire, parfois jusqu’aux larmes.
Personnellement, j’ai particulièrement apprécié la mise en abyme à la toute fin de la pièce, alors que tous les acteurs se réunissent sur scène et lisent tous en chœur un extrait du livre Le malade imaginaire de Molière. Sans vous dévoiler la fin, pour ceux qui n’auraient pas lu Molière, disons seulement que la pièce se termine par une escalade qui nous tient en haleine jusqu’à la tombée du rideau! La touche finale rend hommage au livre de Molière, et c’était une belle attention de la part du metteur en scène.
Je ne peux rester objective après avoir passé un si beau moment en compagnie des personnages de Molière. Ainsi, la seule chose qu’il me reste à ajouter est que la pièce est présentée au Théâtre du Rideau-Vert jusqu’au 29 février et que vous n’avez qu’à visiter ce site https://www.rideauvert.qc.ca/piece/le-malade-imaginaire/ afin de vous procurez des billets.
Finale de la pièce
Bonne soirée au théâtre à tous!
Article de Marie-Soleil Rochon
Présentation du « Prix Robert Vallée »
Par monsieur Jean-Philippe Doucet,
MONTRÉAL | Le vendredi 8 novembre dernier, le Rousseau-Royal de Laval-Montréal a profité de sa joute face à l’Intrépide de Gatineau pour présenter un nouveau prix qui sera attribué à un hockeyeur de l’organisation à la fin de la saison. La nouvelle mention portera le nom du « Prix Robert Vallée », en l’honneur du réputé photographe Robert Vallée et sera remise à la ʺ4e étoileʺ du Rousseau-Royal.
Dévoué, disponible, courageux et travaillant sont quelques descriptifs qualifiant bien l’homme honoré par le Rousseau-Royal de Laval-Montréal, Robert Vallée.
Œuvrant plus souvent qu’à son tour loin des projecteurs à titre de photographe, Robert Vallée est un homme très respecté autour de la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), pour y avoir investi près de 42 ans de son parcours à immortaliser les jeunes hockeyeurs québécois.
Des centaines et des centaines de hockeyeurs québécois, dont Martin St-Louis, Roberto Luongo et plus récemment Alexis Lafrenière ont tous été, à un moment ou un autre, ciblés par la caméra de Robert Vallée, qui lui, en réalisait ensuite un chef-d’œuvre visuel.
La récompense qui portera le nom du photographe sera remis au travailleur le plus acharné de l’équipe. Celui qui fournit un effort constant et qui est indispensable au succès de l’équipe, sans nécessairement apparaître au tableau de pointage.
« C’est vraiment un sentiment spécial! C’est le premier trophée en mon nom, ça me touche beaucoup, surtout que ça provient de ʺvrais chumsʺ », souligne le photographe ému par la nomination faite par le Rousseau.
Le vétéran de la photographie ne s’en cache pas que de voir son nom associé au trophée de la 4e étoile est un sentiment particulier, d’autant plus que Martin St-Louis, un joueur qu’il connaît très bien, a reçu le même honneur au sein de la Ligue de hockey midget AAA du Québec.
« De pouvoir être reconnu comme l’a été Martin St-Louis auparavant, c’est très touchant pour moi », suggère Robert Vallée qui porte en très haute estime l’ancien numéro 26 du Lightning de Tampa Bay.
Un homme fort apprécié à travers la ligue
Évidemment, au terme de ses 42 années à photographier la relève du hockey québécois, le principal intéressé a fait sourire bien des dirigeants à travers la ligue, dont Georges Marien, directeur général de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, qui se dit très heureux de l’attribution de ce prix par l’organisation montréalaise.
« C’est une belle initiative de la part du Rousseau-Royal. C’est un honneur pleinement mérité pour un homme qui est un exemple pour tous. » - Georges Marien (DG de la ligue)
Au fil des dernières années, le photographe a malheureusement été ennuyé par des problèmes de santé, mais jamais ce dernier n’a baissé les bras et il est, encore à ce jour, un modèle de persévérance pour les gens de son entourage.
« Robert Vallée est un combattant de tous les instants avec les problèmes de santé qu’il a eu au cours des années récentes », affirme Georges Marien
Malgré les épreuves, Robert Vallée a gardé le sourire et a toujours été le premier à vouloir exercer son métier avec beaucoup de rigueur, chose qu’il fait depuis le jour 1 de son expérience à titre de photographe.
« On parle ici d’un homme pour qui le professionnalisme n’a jamais fait défaut », souligne Georges Marien.
Au nom du Rousseau-Royal, nous sommes fiers que cet honneur portera dorénavant le nom du « Prix Robert Vallée » et nous souhaitons la meilleure des chances à ce dernier dans sa plus récente lutte contre la maladie.
Jeune intellectuel chevronné et philanthrope naturel, Jean-Philippe Doucet, aka jeune Doucet, recherche constamment de nouvelles vérités sur le monde qui l’entoure. Sa curiosité et son ardeur au travail le placent en excellente position dans la course au poste de rédacteur en chef du ComMédia à l’hiver 2020.
Annuler ou abandonner un cours?
Par Marie-Charlette Mfera
Je veux partager avec vous une situation qui m’est arrivée dernièrement et qui m’a fait réfléchir. Avant ce moment, je ne m’étais jamais posée certaines de ces questions, mais comme on dit, il suffit de vivre quelque chose pour obtenir une nouvelle perspective. Ne vous en faites pas, je ne vais pas garder le suspens plus longtemps ; la thématique qui a attiré mon attention est la date limite qu’on a pour annuler un cours.
Dans le calendrier de l’Université, il est possible de voir deux termes qui veulent dire pratiquement la même chose, mais qui restent différents. On peut remarquer qu’il y a une date pour annuler et modifier un cours et une autre pour l’abandonner avec un astérisque à côté (ce symbole est très important, je tiens à le souligner).
Grâce à cet astérisque, il est possible de comprendre que lorsqu’on abandonne un cours, c’est parce qu’on est conscient qu’on va enlever ce cours de notre horaire, que dans notre relevé scolaire ce cours va avoir une mention d’abandon et qu’on sera quand même responsable de payer le prix du cours en totalité.
Jusqu’à présent, vous me suivez? Parfait, on continue! Je suis d’accord avec le fait que l’Université de Montréal applique dur comme fer certains de ses règlements ; sans eux il y aurait pas mal de chaos, mais je me questionne sur le temps qui nous est accordé pour procéder à l’annulation d’un cours.
Prenons-en exemple ce trimestre, il a commencé le 3 septembre, cependant durant cette semaine ce ne sont pas de vrais cours qui ont été donnés. Je veux dire, la première semaine, les professeurs parlent du plan de cours et du déroulement des séances à venir. C’est vraiment à partir de la deuxième semaine qu’on plonge dans la matière et encore là j’ai l’impression que les étudiants reprennent tranquillement l’habitude d’être en classe après les vacances d’été. Ensuite arrive la semaine de délibération où on doit faire notre choix, à savoir si OUI ou NON on reste dans ce cours. Est-ce que je suis seule à avoir tout juste eu le temps de cligner des yeux, et « boum! », me retrouver à prendre cette décision?
Si vous n’avez jamais eu à annuler un cours, peut être que la date d’annulation des cours vous rend indifférent. Peut-être que si vous avez annulé votre cours dans la première semaine, si vous, vous vous êtes vite rendu compte que la matière ne vous intéressait pas ou que le style d’enseignement du professeur ne vous convenait pas, vous n’allez pas comprendre ce dilemme. En revanche, qu'advient-il à l’étudiant qui a trouvé la matière intéressante, qui a de la difficulté à comprendre le professeur, mais qui persévère, malgré tout, durant les premières semaines en posant des questions au professeur et en faisant ses lectures chaque semaine, dans le but, bien sûr, de comprendre le cours? N’a-t-il pas le droit d’épuiser toutes ses ressources avant de soulever son drapeau blanc, sans être pénalisé?
Personnellement, je crois que le délai de trois semaines pour pouvoir annuler son cours sans payer les charges de celui-ci est peu. Je comprends que certaines personnes me diront l’argument suivant : « si tu annules le cours plus tôt, un autre étudiant peut avoir la chance de s’inscrire, et si tu annules après trois semaines, tu devrais payer la place que tu as occupé ». Pour répondre à cet argument, j’aimerais qu’on se place dans la mise en contexte. Je me dis que même si un étudiant annule son cours à la troisième semaine, il serait intéressant de connaître la fréquence à laquelle d’autres étudiants s’inscrivent à ce cours, en sachant qu’ils en ont déjà manqué deux autres qui seront matière à l’examen. Je ne vais pas vous mentir, je n’ai pas les statistiques, mais je pense que c’est assez rare.
Honnêtement, je suis d’accord qu’après un certain temps il faille payer des frais d’annulation, mais pas le prix d’un cours au complet! La plupart de nous (les étudiants) n’avons pas un extra 300 $ à jeter par la fenêtre. À la suite du présent règlement de l’Université, je n’ai pas l’impression que ce système d’éducation est ajusté pour le besoin de l’étudiant, mais plutôt pour le système économique de l’Université. Je pense qu’il est important que l’Université encourage l’étudiant à réussir sa session, sans lui mettre de pression plus que nécessaire.
Qu’en dites-vous? Pensez-vous que trois semaines, c’est assez pour pouvoir annuler un cours, sans les frais supplémentaires? Est-ce qu’à la suite d’un abandon de cours on devrait payer le prix total de celui-ci, et ce, même si on en verra jamais la fin?
Source de l’image
https://pixabay.com/fr/photos/remise-des-dipl%C3%B4mes-dipl%C3%B4me-1449488/?fbclid=IwAR2fcqEYWpySDx7PuUWOBj19XXKJBf_oqSS3emFv-M34CPAn_3zDJQ_shAY
Anti-héros superstar!
Par Chanel Robin
Quand Marilyn Manson se révèle un hybride entre postmoderniste et post-humaniste et aide à comprendre certains concepts du cours COM1350 (Communication, cognition et émotions)
Vous en avez sûrement entendu davantage parler en mal qu’en bien (gore, provocateur, voire même incitateur à la violence), mais Marilyn Manson est, selon moi, un artiste de performance dont la démarche mérite d’être analysée plus en profondeur. Ce musicien américain de métal industriel, connu entre autres pour avoir popularisé et revisité à sa manière des succès comme Sweet Dreams (Are Made of This), Personal Jesus et Tainted Love, a aussi écrit plusieurs albums-concepts qui expriment une féroce désillusion face aux promesses de notre société actuelle postmoderne. On peut aimer son style ou non, mais il nous fait comprendre par sa grotesque critique de la société nord-américaine qu’il n'est pas différent de nous, au fond.
Marilyn Manson, avant d’être musicien, était journaliste. Cela lui a permis de s’immiscer dans le monde artistique tout en gardant l’œil ouvert sur les bons et les moins bons côtés de l’industrie et son influence sur la société. Comme lui, en tant qu’étudiant.e.s en communications, nous sommes plongé.e.s dans une prise de conscience privilégiée des conséquences des médias dans nos vies. Ces derniers sont à la base de notre société postmoderne, nous rendant inactifs devant ce bombardement incessant d’images et d’informations. Analysons avec lui où nous en sommes rendus en tant que société.
Avant de commencer, voici une petite mise en contexte : après la modernité, les changements technologiques ont modifié radicalement toutes les sphères de l’existence humaine, mais aussi notre vision du monde. Nous voilà en pleine postmodernité. On délaisse la binarité (bon-mauvais ; moi-l’autre ; homme-femme) pour un mélange des styles, des genres, un métissage culturel qu’on appelle hybridité . Avec la technologie qui s’immisce même jusque dans le corps humain, il y a un autre après qui nous attend : le post-humanisme.
Ci-dessous : La couverture de l’album Mechanical Animals sorti en 1998. On peut déjà y observer l’hybridité du genre (ni homme ni femme, plutôt agenre), mais aussi l’humanoïde, (homme-clône). Voici un bref aperçu des notions de post-humanisme et d’hybridité. (Source de l’image : Wikipédia)
« Les personnages postmodernistes semblent souvent ne pas savoir très bien dans quel monde ils se trouvent et comment ils doivent agir », nous dit David Harvey (Balutet, 2016, p.7). Omega, l’alter ego de Marilyn Manson, en est un parfait exemple. Ce cher extraterrestre, vedette de glam rock débarqué sur Terre en 1998, se raconte à travers les 14 chansons de l’album Mechanical Animals. Si vous et moi pouvons parfois nous sentir perdus dans ce monde, imaginez Omega. Vite influencé par le mode vie américain, le protagoniste se sent rapidement perdu et sa santé mentale en est atteinte.
Toutes les chansons décrivent ce sentiment d’absurdité et de flou existentiel. Et c’est surtout là-dessus que l’artiste insiste dans ses textes : il veut fuir ce mal-être.
La chanson la plus iconique pour le démontrer : I Don’t Like The Drugs, But The Drugs Like Me. Quelle drogue exactement ? Ce n’est pas précisé, car le mot « drogue » doit être compris à un sens plus large, englobant à la fois le bigotisme religieux, le divertissement de masse à la télévision ou la surconsommation, des addictions sur lesquelles la société se raccroche pour faire taire les angoisses. S’en dégage une sorte de fatalité, présente même dans le titre de la chanson : c’est comme si tôt ou tard, même s’il n’aime pas ce monde postmoderne, le protagoniste y succombera parce que la religion fait tout pour garder ses fidèles. Les compagnies misent sur la publicité pour attirer ses consommateurs, idem pour la télévision qui veut que ses téléspectateurs restent à l’écoute. Parce que l’addiction a besoin de ses accros pour perdurer.
Le fait d’être un post-humain pour lequel le genre n'a même plus d'importance aurait pu nous faire penser que cela rend Omega plus libre, puisque l’idée de l’homme-machine se veut une amélioration des capacités humaines, mais la chanson New Model no. 15 renchérit dans la perte d’espoir en nous faisant réaliser que sa caractéristique originale n’est que superficielle et lui fait même perdre son individualité : « I’m as fake as a wedding cake […] Pitifully predictable, correctly political. » Sa vie de vedette glam rock, en prenant le dessus sur sa vision objective monde (car extra-terrestre), ne fait que représenter « son vide intérieur » grandissant (Mallier, 2016, p. 26).
S’ajoutent à ces réalisations anxiogènes le fait qu’en participant à la société de consommation de masse, il réalise qu'il prend part malgré lui à la destruction du monde, autant des relations entre humains que de la planète en tant que telle : « Relationships are such a bore / Delete the one that you’ve f*cked» (User Friendly). En 1998, les réseaux sociaux étaient loin d’être aussi développés : cette phrase se révèle prémonitoire et résonne d’autant plus en 2019 alors que nos relations virtuelles sont souvent basées sur l’immédiateté et établies à distance par l’intermédiaire de nos écrans. Une autre caractéristique du postmodernisme, ces temps et espace.
Pour terminer ce survol de l’album, l’avant-dernière chanson The Last Day On Earth nous laisse sur un bémol, alors qu’Omega devient un témoin passif et impuissant devant la destruction de la planète. Cela n’est pas sans rappeler l’écoanxiété que la récente grève pour le climat a dénoncé en trombe.
…
Le temps ne veut rien dire, on parle d’instantanéité. Les distances, franchissables par un portail appelé écran. Plus de vérité, il faut l’investiguer, la questionner, la discuter, car le faux parvient parfois à se mêler au vrai avec une illusion assez surprenante. Non, ceci n’est pas le synopsis d’un film de science-fiction. C’est simplement notre époque : la postmodernité. Il y a de quoi se sentir dépassé, éparpillé, de ne pas être si original que ça, d'avoir tout pour fonctionner, mais… Il y a toujours un mais... Les chers êtres postmodernes que nous sommes sont en proie à des remises en question incessantes, que ce soit sur notre identité ou notre relation avec le monde. Une sorte d'anxiété générale qui joue en trame de fond (qui devient parfois plus assourdissante) de nos vies. Malgré tout, « ça va aller », comme nous dit l'UdeM*. Il le faut bien.
(Si cela vous intéresse, je me suis amusée l’année dernière à faire une première réflexion sur l’impact de la technologie dans notre société, mais avec le point de vue d’Alex Turner dans le plus récent album de son groupe Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino :
Références :
(Pour de plus de détails sur la postmodernité, le posthumanisme et l’hybridité):
Balutet, N. (2016) Du postmodernisme au post-humanisme : présent et futur du concept d’hybridité. Babel, 33, DOI: 10.4000/babel.4391
(Une superbe analyse de trois albums phares de Marilyn Manson connus sous le nom de « trilogie inversée ») :
Mallier, C. (2010). Marilyn Manson, antéchrist superstar. Revue française d’études américaines, 125(3), 85-100. doi:10.3917/rfea.125.0085.
*Lien pour la campagne Ça va aller de l’UdeM: https://www.cavaaller.ca/
27 septembre : Une journée importante pour le climat
Par Marie-Soleil Rochon
C’est le 27 septembre prochain qu’aura lieu la manifestation pour le climat dans les rues de Montréal. Mais c’est aussi à cette date qu’aura lieu la finale du défi AquaHacking, une compétition dans laquelle six équipes finalistes devaient développer des solutions technologiques pour résoudre les problèmes reliés à la pollution de l’eau douce. Cet événement s’inscrit dans la démarche pour faire réfléchir nos décideurs politiques sur les conséquences des changements climatiques. La date de la finale de ce défi concorde parfaitement avec la marche pour le climat à laquelle Greta Thunberg, initiatrice de ces mouvements partout à travers le monde, participera.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, Greta Thunberg est une militante suédoise pour la lutte contre le climat. Déjà, à l’âge de 15 ans, elle protestait devant le Parlement suédois contre l’inaction face aux changements climatiques. Elle est à l’origine de plusieurs grèves scolaires pour le climat partout dans le monde, dont une qui a eu lieu le 15 septembre dernier, à Montréal, et à laquelle plusieurs associations d’écoles secondaires, de cégeps et d’universités ont participé. Plusieurs associations de l’Université de Montréal étaient d’ailleurs présentes lors de cette journée importante. Depuis le 15 mars dernier, Greta Thunberg continue d’entreprendre des démarches afin de sensibiliser les communautés de partout à travers le monde aux changements climatiques et à l’urgence d’agir. Elle a d’ailleurs été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019. Le député norvégien ayant soumis sa candidature a mentionné que « Greta Thunberg a lancé un mouvement de masse dans lequel [il voit], peut-être, la principale contribution à la paix. » (Le Devoir, 2019)
La prochaine manifestation pour le climat aura lieu le 27 septembre prochain et il a été confirmé que la jeune Greta Thunberg sera des nôtres. D’ailleurs, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, recevra la jeune suédoise lors de la manifestation afin de lui remettre les clés de la ville. La manifestation citoyenne et étudiante pour le climat débutera dès midi au monument George-Étienne Cartier sur le Mont-Royal.
Le défi AquaHacking, pour sa part, est l’une des compétitions technologiques les plus intenses au Canada. Depuis le mois de juin, six équipes mettent tout en œuvre pour développer leurs recherches afin de contrer la pollution de l’eau douce. AquaHacking est un événement qui, en plus de promouvoir de nouvelles technologies pour contrer la pollution de l’eau, se veut rassembleur pour tous les jeunes et moins jeunes sensibles aux enjeux environnementaux.
Les six équipes finalistes présenteront leurs projets le 27 septembre, au Grand Quai du Port de Montréal, dès 14h30. La finale d’AquaHacking sera clôturée par les prestations de Koriass et de DJ Manifest dès 19h30.
Si vous souhaitez vous impliquer dans les questions environnementales qui touchent notre société, le 27 septembre est LA journée pour vous impliquer!
Venez marcher avec nous en grand nombre et venez assister au dévoilement de nouvelles technologies pour réduire la pollution.
Être Asperger et étudier à l'université - Les statistiques, les défis et les bons coups
Par Jérémie Bellefleur
C’est parti, ça y est, une nouvelle année universitaire qui s’installe tranquillement. Un peu trop vite pour certains, peut-être, mais revoir des visages familiers, ça remonte souvent le moral. Lors de ma première soirée avec les autres étudiants du programme, il y avait ce visage, inconnu pourtant, qui faisait rire, comblait les silences, parlait à tout le monde… sans gêne véritable. Il s’insérait bien, et personne ne semblait vraiment le connaître. Quelle ne fut pas ma surprise quand il lâcha tout d’un coup, entre deux phrases, qu’il était diagnostiqué d’un trouble de l’autisme! En deuxième année en mathématiques! J’étais impressionné.
Au Québec, en 2018, il y avait 14 652 étudiants inscrits à l’université qui étaient considérés en « situation de handicap ». La majorité d’entre eux, à 36 %, étaient diagnostiqués d’un déficit de l’attention. Venaient ensuite, à 16 %, les problèmes de santé mentale, particulièrement mis de l’avant ces derniers temps par diverses campagnes dont vous connaissez déjà les slogans. Un total de 13 %, parmi eux, présentaient une difficulté d’apprentissage, alors que les autres se voyaient surtout accaparés par des handicaps d’ordre physique. En outre, 146 personnes autistes suivaient des cours aux universités du Québec ; l’équivalent d’un pourcentage de la somme des 14 652. Mon nouvel ami en faisait partie.
Cet ami, que j’espère revoir en vérité, vit avec le syndrome d’Asperger ; une branche de l’autisme qui exclut la déficience intellectuelle. Les gens Asperger sont généralement associées à une difficulté à interagir socialement, en particulier sur le plan des émotions. Ils ont régulièrement du mal à saisir les nuances du langage, tel que le sarcasme, ou à traiter certaines formes de communication. Et pourtant, il était là, mon camarade, en train de socialiser à la fin d’une bonne journée de cours. Cela ne serait peut-être pas arrivé si j’avais étudié il y a 11 ans : les étudiants en « situation de handicap », les 14 652, étaient dix fois moins nombreux en 2008. Cette hausse significative s’explique en partie par l'accroissement de la population, mais surtout grâce aux avancés scientifiques permettant de repérer et de diagnostiquer les enfants en bas âge, puis de les épauler tout au long du primaire et du secondaire (oui, oui, la fameuse maternelle quatre ans).
Malheureusement, c’est là que se trouve le hic, car après le secondaire le soutien se fait moins présent, du moins en termes de ressources humaines et monétaires. Le gouvernement investit 2 milliards par année aux niveaux primaire et secondaire afin de répondre à ce genre de besoins. Le budget accordé aux établissements postsecondaires, par contre, ne suit pas le même rythme, et plusieurs de ces milieux réclament davantage de fonds pour opérer leurs services.
En fait, la réussite d’un élève Asperger dépend surtout des services mis à sa disposition. Il peut réussir à l’école aussi bien que n’importe quel élève, même mieux encore, puisque l’intelligence serait parfois supérieure chez les personnes Asperger. Seulement, la réussite scolaire dépend plutôt de tout un tas de facteurs comme l’organisation, la prise de notes, la gestion du temps, etc. Les enseignants ne sont pas formés, généralement, pour répondre à ce défi. Il leur faut être équitable auprès de tous et il n’est pas exclu que les autres étudiants soient embarrassés ou dérangés par certaines situations. Au final, il s’agit de cas par cas, de la nécessité d’une aide spécialisée avec à son appuie de l’argent et du personnel qualifié.
Heureusement, les universités ont adopté des politiques de « soutien aux étudiants en situation de handicap » ; le SESH, ici, à l’UdeM, qui prend en charge ces services. Il y a des bourses à gagner, des accommodements aux examens, des prises de rendez-vous, des conférences en ligne pour former les enseignants, etc. Il y a même le Guide d’accompagnement des étudiants en situation de handicap en contexte de stage : Travaillez ensemble pour leur réussite. Ce dernier est important car le secteur professionnel constitue un défi supplémentaire. Tout de même, leurs capacités sont de plus en plus reconnues par les employeurs. Ils décrochent de plus en plus de diplômes. Je ne suis pas trop inquiet pour cet ami d’un soir. J’ai même d’excellentes chances de le revoir.
PS : Même Greta Thunberg est Asperger! ;)
Références :
http://quartierlibre.ca/autiste-et-etudiant/
https://www.erudit.org/en/journals/ef/2016-v44-n1-ef02469/1036169ar.pdf
https://www.journaldemontreal.com/2017/04/15/miser-sur-les-autistes-pour-performer
L'intelligence artificielle à Montréal - Entrevue avec un chercheur du MILA
L’intelligence artificielle à Montréal
Montréal semblerait devenir le pôle de la révolution de l’intelligence artificielle. En 2017, plus d’un milliard de dollars ont été investis dans ce secteur de développement technologique. Ce qu’on y fait aura, dans quelques années, une influence importante sur le quotidien de millions de personnes à travers le monde. C’est donc à Montréal que se prépare l’avenir des technologies.
Dmitriy Serdyuk est doctorant à MILA (Montreal Institut of Learning Algorithms) et assistant de recherche à Element AI, qui se spécialise dans les produits de l’intelligence artificielle afin d’accélérer la transformation numérique des moyennes et grandes entreprises dans les secteurs de la fiance, l’assurance et la logistique du transport. Les deux dernières recherches de ce spécialiste sont un ajout important au développement de la technologie des commandes vocales et de l’anticipation du futur par les logiciels intelligents. Selon lui, peut-être d’ici 50 ans, nous pourrions nous attendre à avoir une intelligence artificielle très développée qui pourra sûrement rivaliser avec le cerveau humain.
Notez que cette entrevue présente l’opinion personnelle de Dmitriy Serdyuk et non le point de vue de Element AI et de MILA.
Qu’est-ce que Montréal a pour l’industrie de l’intelligence artificielle que les autres villes n’ont pas ?
Montréal a un écosystème où l’on retrouve beaucoup de professeurs et d’étudiants. Aussi, il y a les laboratoires de recherche de Montréal qui se dédient à l’apprentissage automatique, et l’autre point important est que l’écosystème de Montréal est ouvert aux discussions. Ainsi, les chercheurs et les représentants de plusieurs industries se rencontrent fréquemment dans des colloques, des symposiums, comme ce fut le cas de la conférence NIPS 2018 à Montréal, en décembre dernier. Donc, il y a une interconnectivité qui nous rassemble à Montréal.
Après votre dernier article Towars End-to-end Spoken Language Understanding, pourriez-vous l’expliquer en détail ?
Mon dernier article est Towars End-to-end Spoken Language Understanding qui explore l’idée de combiner deux différentes étapes pour la compréhension du langage. Alors, quand nous demandons quelque chose à Google Assistance sur notre téléphone, par exemple : « Ok Google, ouvre Spotify », le dispositif écrit ce que vous dites sur votre écran et, par la suite, essaye de décoder le texte pour ensuite réaliser la commande. J’ai donc essayé de combiner et de simplifier la procédure, et l’une des raisons principales est que lorsque vous avez une procédure multiple, des erreurs peuvent survenir à chaque étape et s’accumuler. Par exemple : vous lui demander d’ouvrir une page Spotify, mais en le retranscrivant il comprend autre chose, et ouvre une page YouTube. Ce dernier travail de recherche vient simplifier le tout en éliminant une étape, soit l’écriture de la commande. Donc, Google Assistance, par exemple, écoutera et agira plus rapidement sans avoir à retranscrire ce qui est dit.
Comment est-ce que vos recherches s’appliquent-elles dans la vie de tous les jours?
C’est utile pour l’assistance automatique et la transcription de texte. Par exemple, quand quelqu’un fait une entrevue, vous avez alors besoin de la retranscrire à la main, alors que vous pourriez utiliser le système de reconnaissance de texte qui sera en mesure de tout retranscrire automatiquement. Le but ultime serait d’avoir une assistance intelligente qui serait capable d’interagir avec les gens.
Quels sont les différents domaines étudiés au MILA ?
Il y a des domaines tels que la vision, l’apprentissage par renforcement, les études sur la formation de logiciel dans l’environnement de l’intelligence artificielle et l’imagerie médicale. Aussi, il y a un peu de recherche sur la robotique, la langue naturelle qui inclut la traduction automatique, ainsi que la synthèse ou le résumé rapide de texte, et c’est pas mal tout.
Avec toutes ces recherches pour le développement des technologies propulsées par l’intelligence artificielle, y a-t-il des domaines moins étudiés ou même délaissés par les chercheurs par simple manque de popularité ?
Je dirais que mon domaine d’expertise, l’audio, est le domaine le moins populaire, comparé à d’autres comme la vision ou le traitement du langage naturel. C’est comme une « tendance mode » qui revient et s’en va, parce que c’était populaire en 2012, et, maintenant, sa popularité est très en baisse. Donc, probablement que dans l’avenir sa popularité va augmenter. Le domaine le plus populaire, en ce moment, est peut-être la vision, qui permet à l’intelligence de comprendre ce qui peut être dessiné ou écrit.
La start up Lyrebird qui est spécialisée dans la copie de voix de gens a lancé une publicité incroyable où elle a copié la voix de Barack Obama pour lui faire dire ce qu’elle voulait dans une courte vidéo. Expliquez-moi les aspects positifs et aussi négatifs de la création de ce genre de dispositifs vocaux ?
N’importe qui pourrait faire la même chose chez soi avec beaucoup de calculs et un peu de travail d’ingénierie. Cependant, vous devez avoir de l’argent pour ça, et des compétences, mais c’est possible. Il faut montrer au public que c’est possible parce que c’est déjà arrivé. Lorsque les gens ont compris qu’on peut modifier des photos avec Photoshop, ils sont devenus plus conscients des fausses photos, comme ils le seront avec des fausses voix.
Ces nouvelles technologies sont-elles les nouveaux esclaves du futur ?
Je pense que nous sommes encore très loin d’avoir une intelligence artificielle forte. Donc, il y a une catégorisation qui définit l’intelligence artificielle forte et faible. Par exemple, une intelligence artificielle faible va résoudre une tâche particulière et avoir une très bonne note, et ce, dans un contexte où le logiciel serait en mesure de faire un travail spécifique comme retranscrire un texte, traduire, reconnaitre des visages ou reconnaitre des voix. Malgré son expertise, il ne peut pas penser comme un humain et s’adapter rapidement à d’autres environnements que celle lui ayant été inculquée. En ce moment, des chercheurs tentent d’apprendre à ce logiciel à s’adapter aux divers environnements. Par exemple, les humains peuvent apprendre dans une classe et appliquer leurs connaissances dans d’autres milieux de leur quotidien, comme lorsqu’ils écrivent à l’extérieur de ce qui est demandé par l’école. Pour le moment, nous avons un logiciel faible. Dans le cas que tu soulèves, tu parles d’une intelligence artificielle forte, comme ce que l’on peut voir dans le film de science-fiction Terminator. Un logiciel pouvant agir, comprendre et exécuter des tâches comme le feraient des humains arrivera peut-être d’ici 50 ans. Je pense que nous avons du temps pour nous adapter.
À quoi devons-nous attendre dans les prochaines années pour l’intelligence artificielle ?
Je pense que dans deux ans, la prochaine étape de l’intelligence artificielle sera de comprendre les causes et effets de différentes actions, parce que, maintenant, nous pensons fortement que le système ne les distingue pas. Une autre étape serait de faire apprendre et agir le logiciel dans l’environnement. Par exemple, il serait possible de faire de simples robots qui seraient en mesure d’apporter votre bière ou votre café. Donc, cela implique l’apprentissage de la navigation dans la pièce, la manipulation simple d’objets de tous les jours et la compréhension de commentaires simples. Ces trois tâches ne sont pas parfaites encore, et nous devons travailler à pouvoir les combiner d’une bonne manière.
par Jeanne Brière, rédactrice du ComMédia