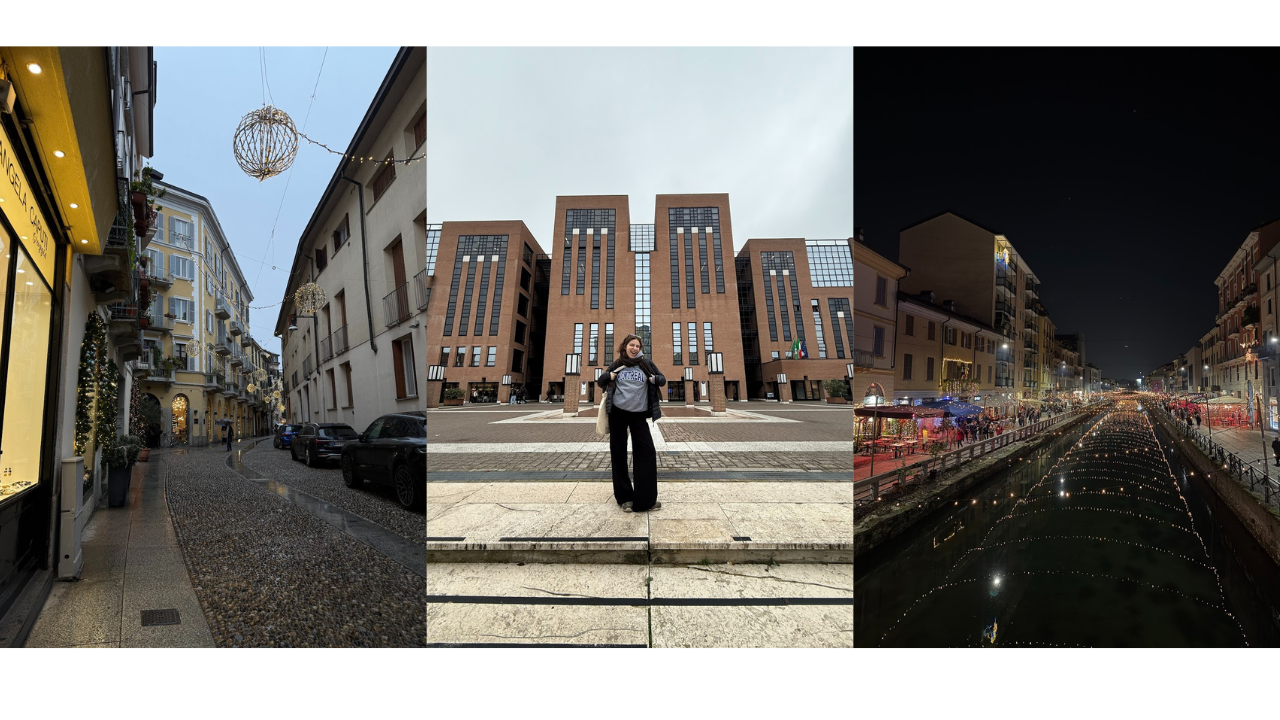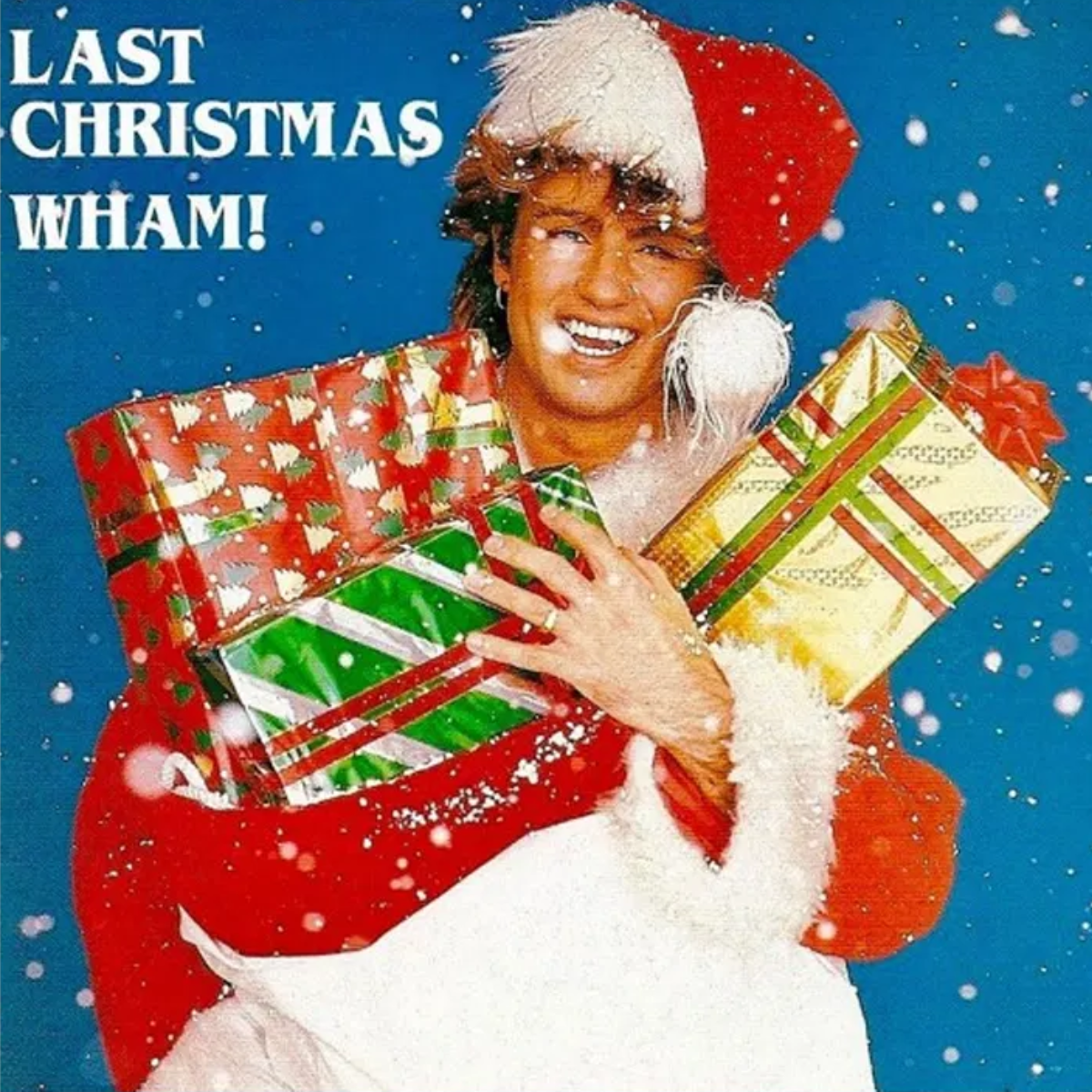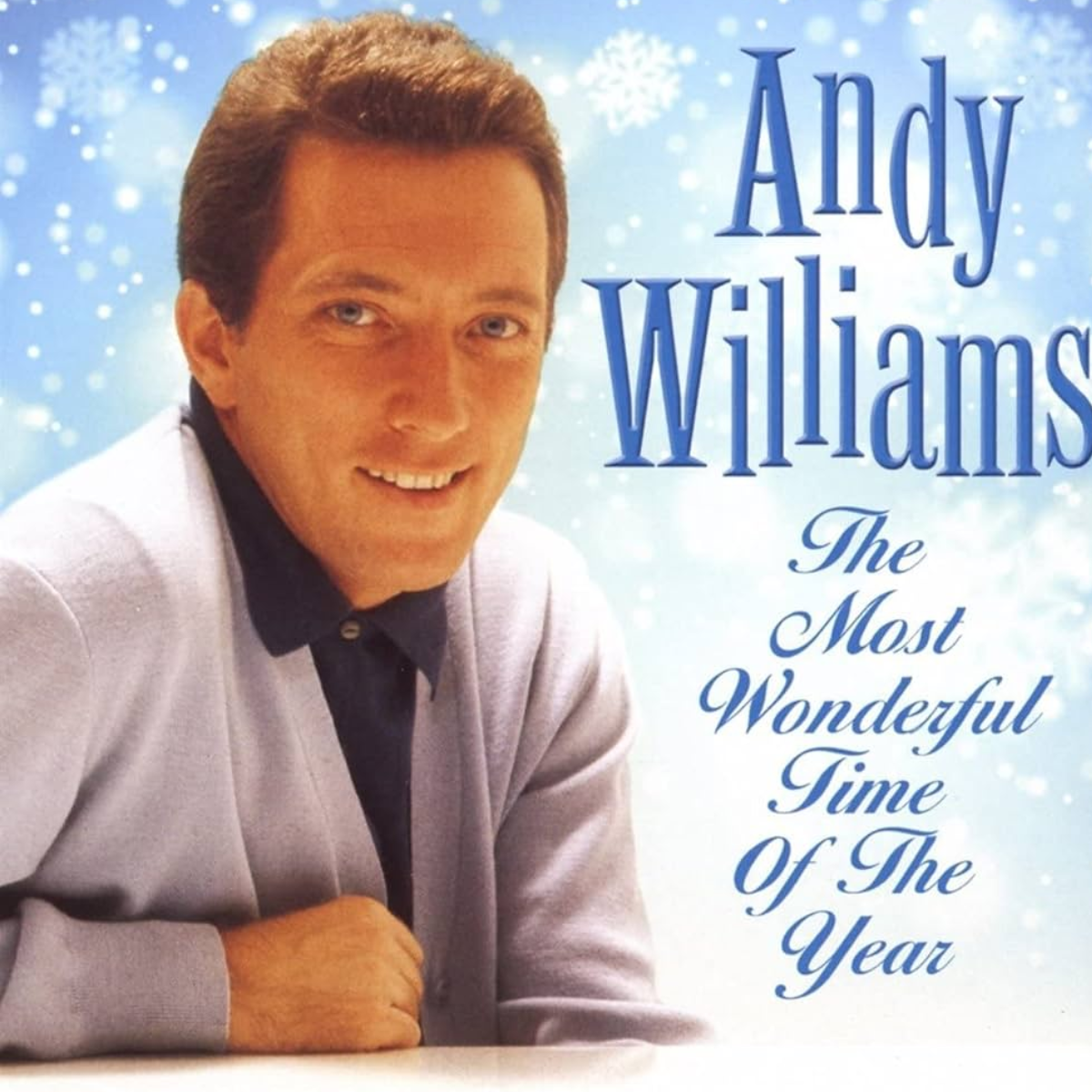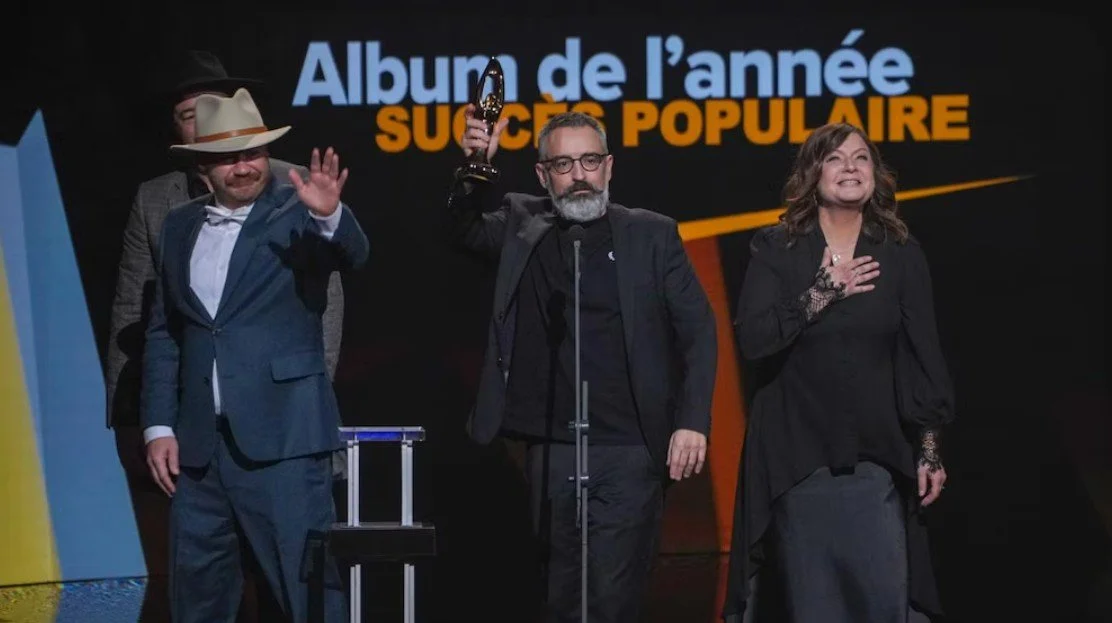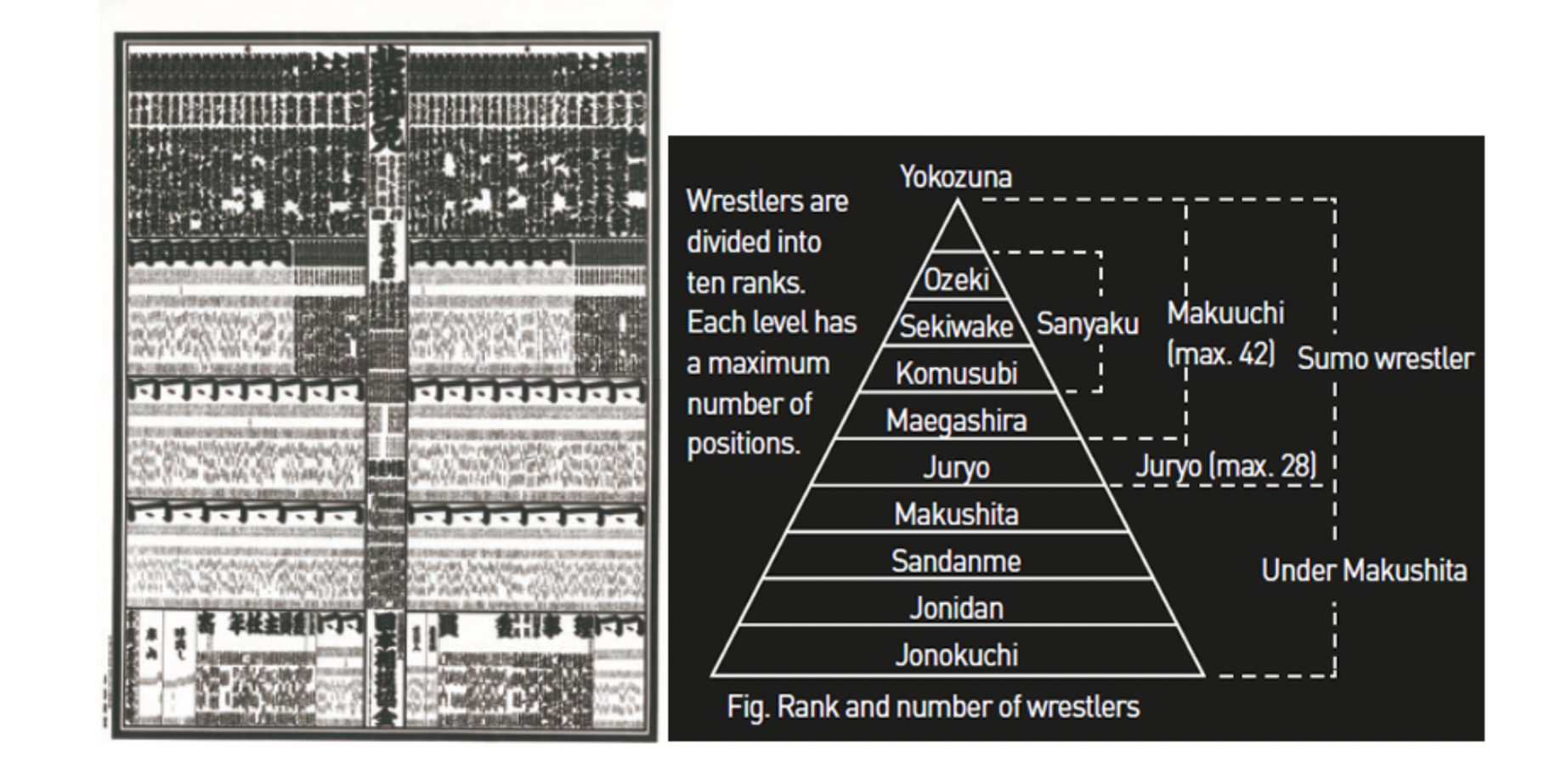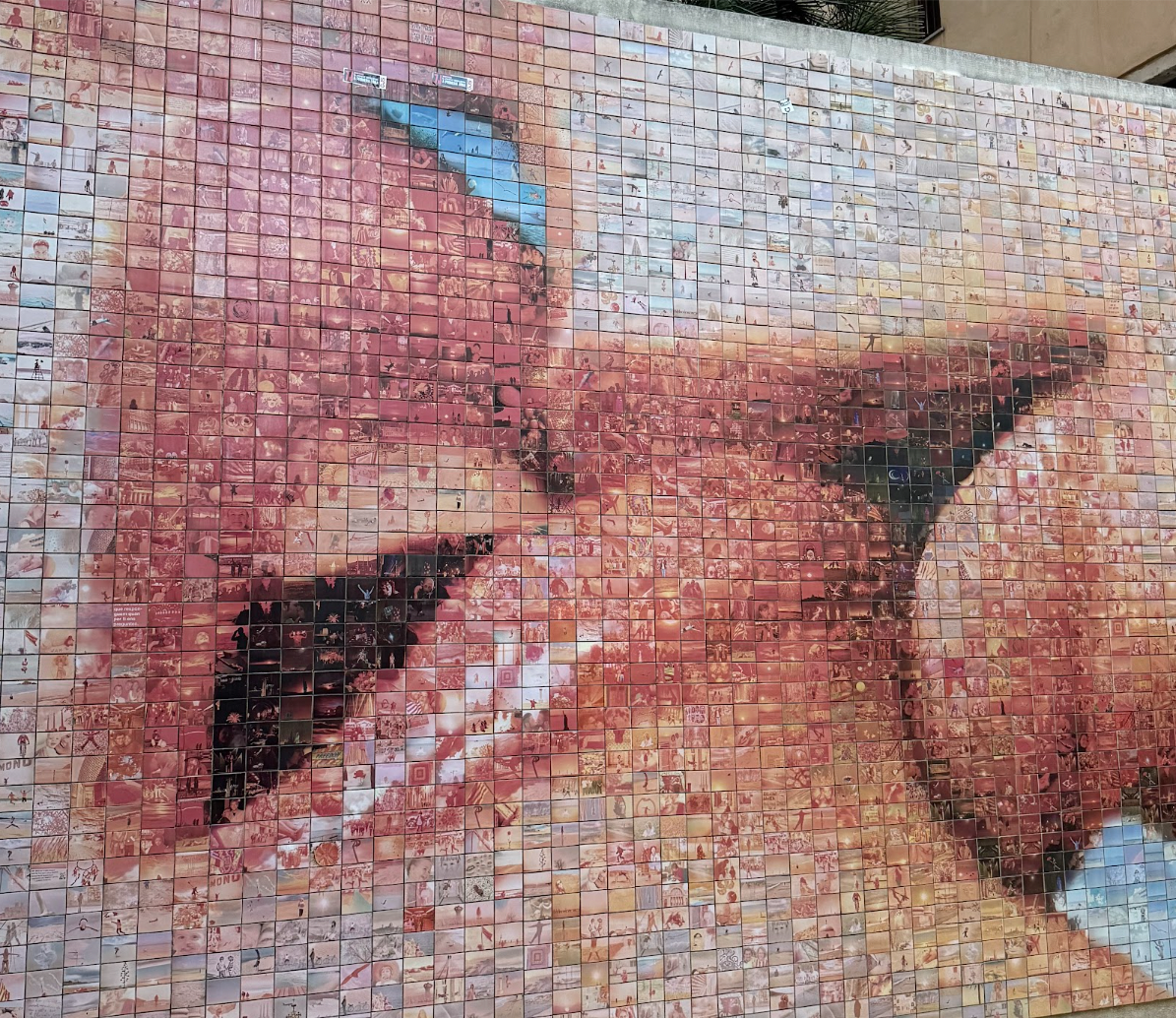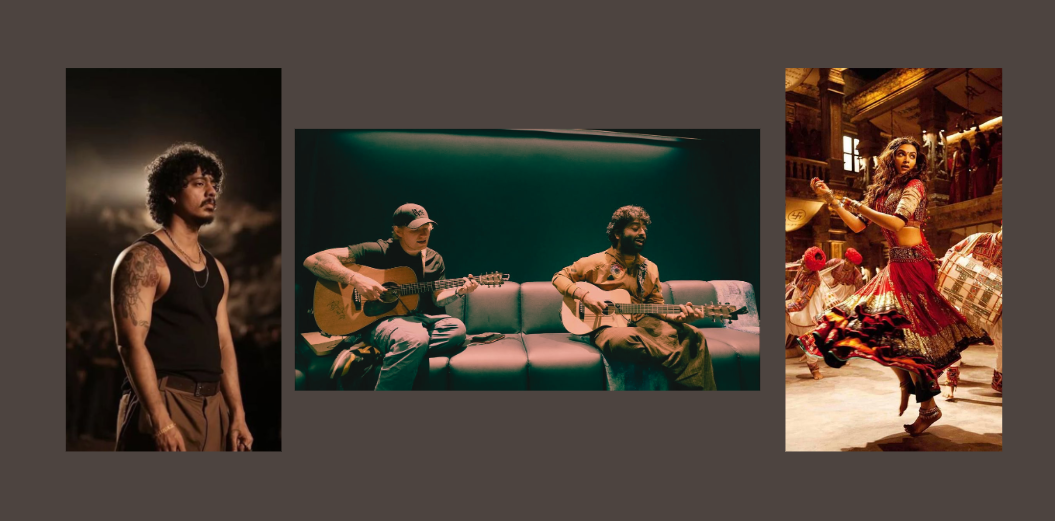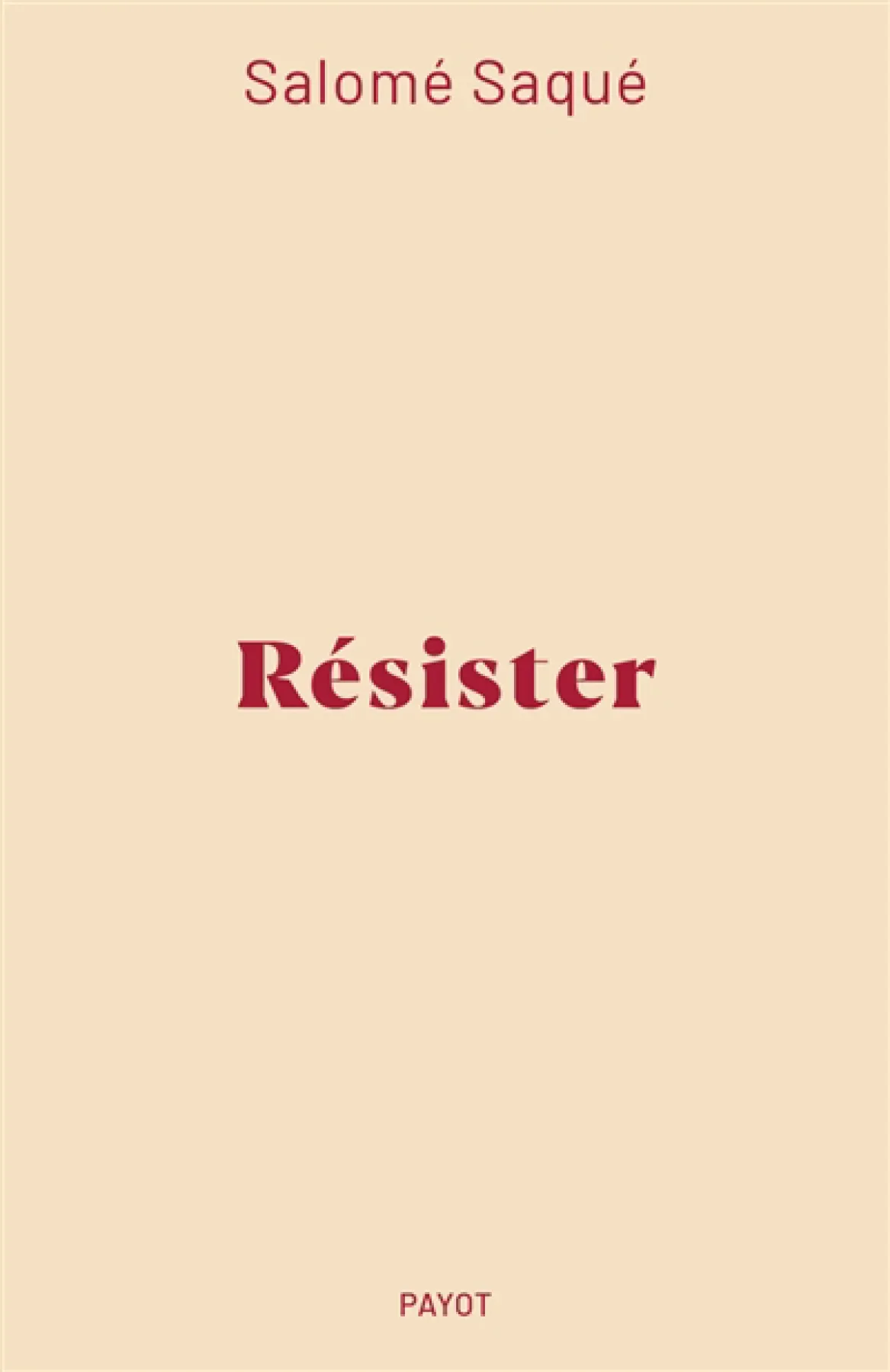MONTRÉAL - Malgré un départ canon, le Canadien a dû s’avouer vaincu face aux Rangers de New York, qui l’ont emporté par la marque de 4-3 samedi soir au Centre Bell.
Un début de rencontre sur les chapeaux de roues
Samedi, il ne fallait pas arriver en retard au Centre Bell. La rencontre n’était vieille que d’une minute et trente secondes lorsque le Tricolore s’est inscrit en premier au pointage, gracieuseté de Juraj Slafkovsky. Après avoir intercepté la rondelle à sa propre ligne bleue, Cole Caufield, lui qui connaît un excellent début de campagne, a filé en deux contre un avec le grand Slovaque, qui a marqué dans une cage complètement ouverte.
À peine deux minutes plus tard, les hommes de Martin Saint-Louis ont profité d’un avantage numérique pour faire scintiller la lumière rouge une seconde fois dans le match. Après une présence soutenue du CH en territoire adverse, Nick Suzuki a tiré profit d’une brillante passe transversale venant de la lame de bâton d’Ivan Demidov pour inscrire son premier but de la saison.
Avec une deuxième vague légèrement remaniée en raison des absences de Dach et de Laine, on a notamment pu voir Suzuki sur la patinoire pour l’entièreté de la supériorité numérique. Cela n’est pas sans rappeler la saison dernière, où Martin Saint-Louis avait utilisé son capitaine de la même façon à quelques reprises.
Les Rangers ont eux aussi profité de l’avantage d’un homme pour marquer leur premier de la rencontre après 11:56 de jeu.
Les deux équipes sont retournées au vestiaire avec un pointage de 2 à 1.
Un point tournant dans le match
À mesure que l’affrontement avançait, on sentait peu à peu les Blueshirts revenir. Ils exerçaient un fort échec avant dans la zone du Tricolore et ont forcé la brigade défensive du Canadien à commettre de nombreux revirements.
Alors qu’il ne restait que quelques minutes au second vingt, Sam Carrick est venu asséner une mise en échec percutante aux dépens de Lane Hutson. Arber Xhekaj, fidèle à ses habitudes, s’est porté à la défense de son coéquipier en jetant les gants face à Carrick. Même si Xhekaj est sorti vainqueur de ce combat, c’est à ce moment que la rencontre a semblé basculer en faveur des visiteurs.
Tout s’écroule en troisième pour le Canadien
On le sentait venir : la forte pression des Rangers allait finir par faire mal au CH. À peine 34 secondes après le début de la période, J.T. Miller a égalisé la marque grâce à un tir dévié dans l’enclave. Ce filet a été le premier de trois inscrits sans riposte par la troupe de Mike Sullivan lors du dernier vingt.
Malgré un regain d’espoir avec un but de Noah Dobson en fin de rencontre, le Canadien a dû baisser pavillon au Centre Bell.
Après tout, le talent brut du Tricolore sera parfois insuffisant pour aller chercher les deux points — surtout quand on est la plus jeune équipe du circuit.
L’équipe ne pourra pas toujours s’en remettre à la magie
Depuis quelque temps, le Canadien nous avait habitué à des fins hollywoodiennes. Sans doute, plusieurs espéraient voir Cole Caufield sortir un lapin de son chapeau pour un troisième match d’affilée, mais cette fois, ça n’a pas été le cas.
C’est un Martin Saint-Louis quelque peu mécontent qui s’est présenté au point de presse de son équipe. Alors qu’on lui a demandé ce qui avait pu provoquer une telle chute de la part de sa formation, il a répondu : « Comme j’ai dit, on va regarder ça. [...] Faut qu’on soit meilleurs. »
À titre de consolation, il s’agissait de la première défaite du Canadien en temps réglementaire au Centre Bell depuis le 9 février dernier.
Des correctifs devront être apportés
Oui, l’attaque massive du Canadien a été concluante ce soir, mais elle n’est visiblement pas à son plein potentiel. L’équipe affiche un pourcentage d’efficacité de 18,2 % en supériorité numérique, ce qui est bon pour le 18e rang dans la ligue.
Au moment où l’on se parle, c’est Juraj Slafkovsky qui est posté sur le flanc droit sur la première unité. Sans rien enlever à son talent, il ne fait pas le travail à cet endroit. Il serait plus utile s’il pouvait mettre à profit son gabarit devant le filet. Toutefois, l’arrivée de Zachary Bolduc, désormais installé dans l’enclave sur la vague initiale, rend ce scénario peu probable.
Tôt ou tard, Ivan Demidov devra forcer la main de son entraîneur pour hériter du poste de Slafkovsky sur l’unité principale. On le voit de plus en plus, le jeune attaquant russe manie la rondelle à cet endroit avec une aisance remarquable. Il trouve sans cesse des brèches dans la défense adverse et crée énormément de mouvement sur une deuxième vague que l’on voit souvent trop peu.
La saison dernière, les partisans ont dû attendre quelque temps avant de voir Lane Hutson prendre la place de Mike Matheson au sein de la première unité d’avantage numérique. Reste à voir si un phénomène du genre se reproduira dans les prochaines semaines dans le cas de Demidov.
Le Canadien affrontera les Sabres de Buffalo lundi, au Centre Bell, avant de s’envoler vers l’ouest du pays pour un voyage de quatre matchs à l’étranger. L’identité du gardien partant pour la rencontre de lundi n’a pas été confirmée.
À suivre.
Christopher Dubuc
Bibliographie
https://www.nhl.com/fr/canadiens/video/apres-match-c-nyr-st-louis-6383060243112 https://montreal.citynews.ca/wp-content/blogs.dir/sites/19/2025/10/habs-1024x767.jpg